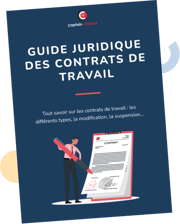Les 4 étapes pour obtenir votre CDD
🚀 Vous développez votre activité, nous gérons votre juridique !
1. Questionnaire en ligne
Notre questionnaire permet de comprendre votre besoin. Commencer
2. Échanges téléphonique
Votre coach choisira l'avocat le plus adapté à votre situation.
3. Appel et obtention du devis
Après un échange gratuit, l'avocat vous propose un devis forfaitaire.
4. Échanges illimités
Votre avocat réalise votre prestation.
Vous êtes entre de bonnes mains

Echanges avec votre avocat et téléchargement de vos documents depuis votre espace entrepreneur : gagnez du temps dans votre démarche.
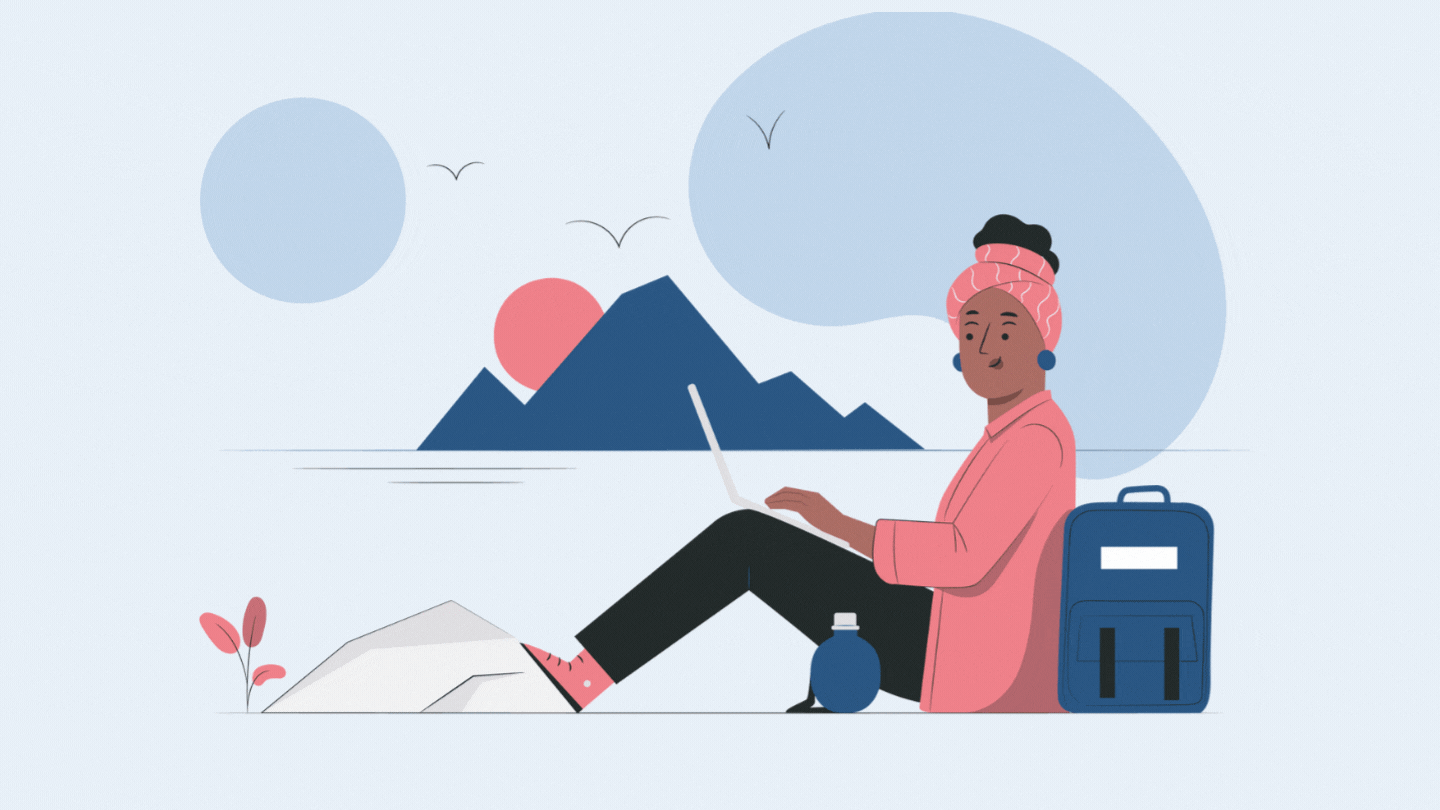
Nos 100 avocats partenaires sélectionnés répondent à chaque besoin juridique grâce à leur expertise sur les différents secteurs d'activités.
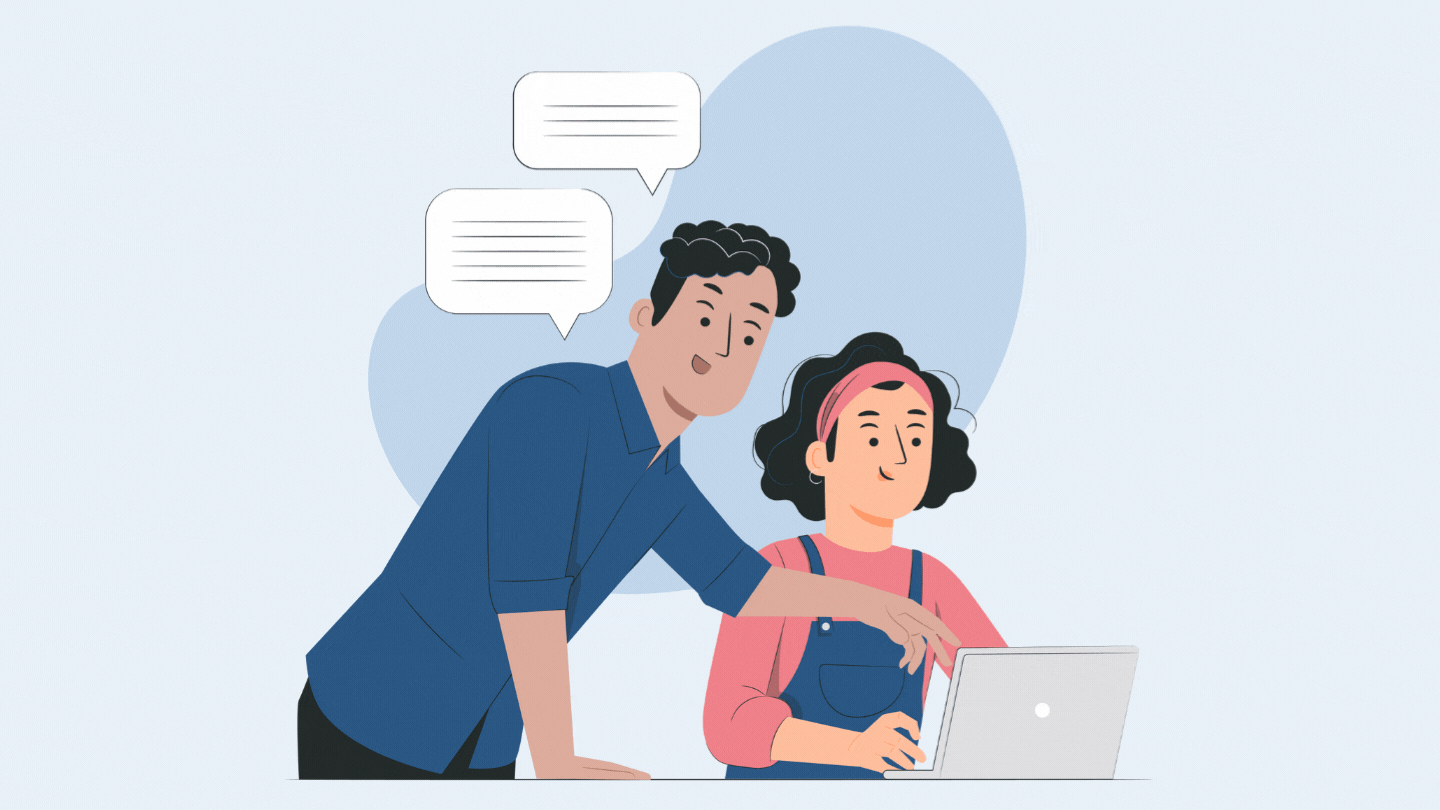
Pour un accompagnement complet, nous avons sélectionné des partenaires fiables : avocats, comptables, banque en ligne etc.
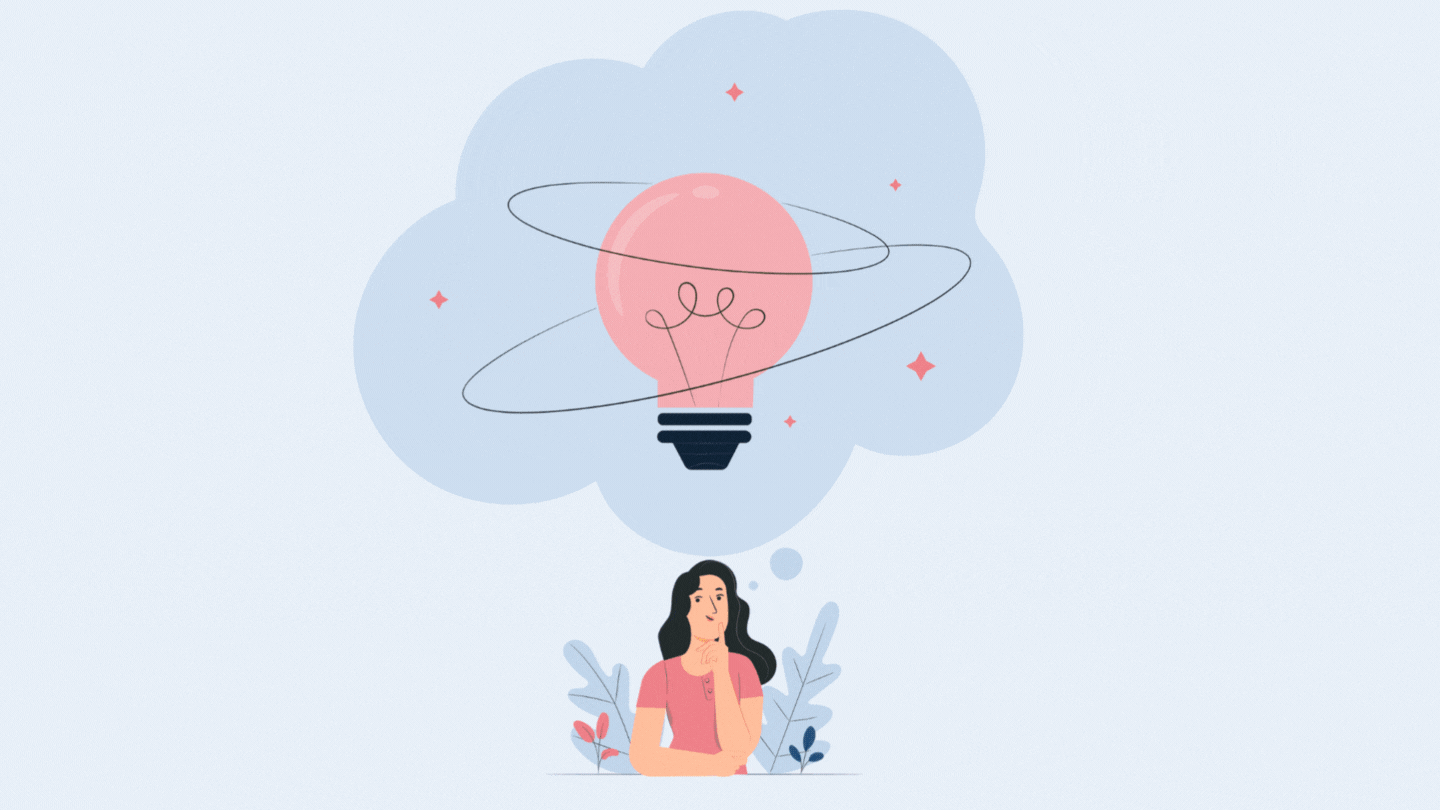

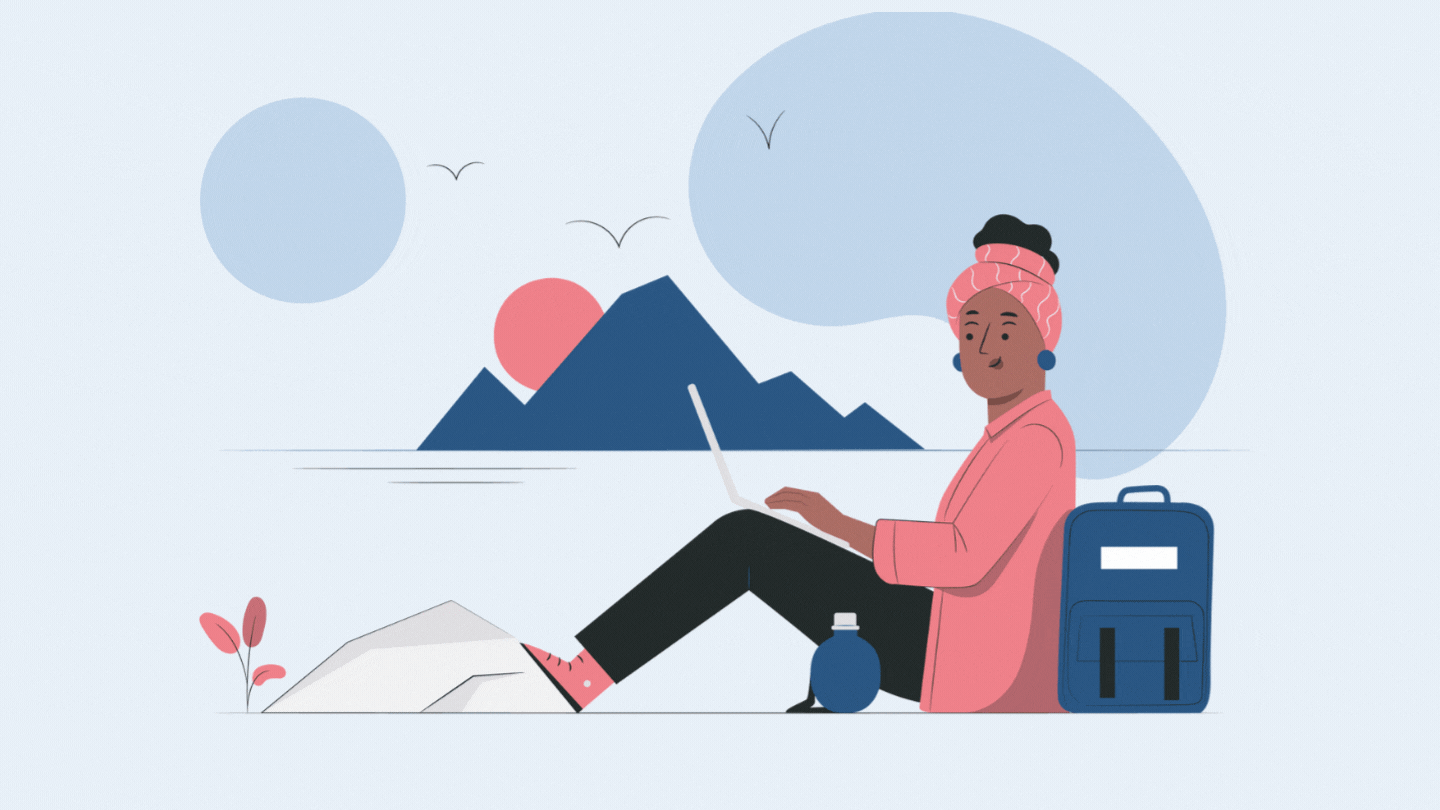
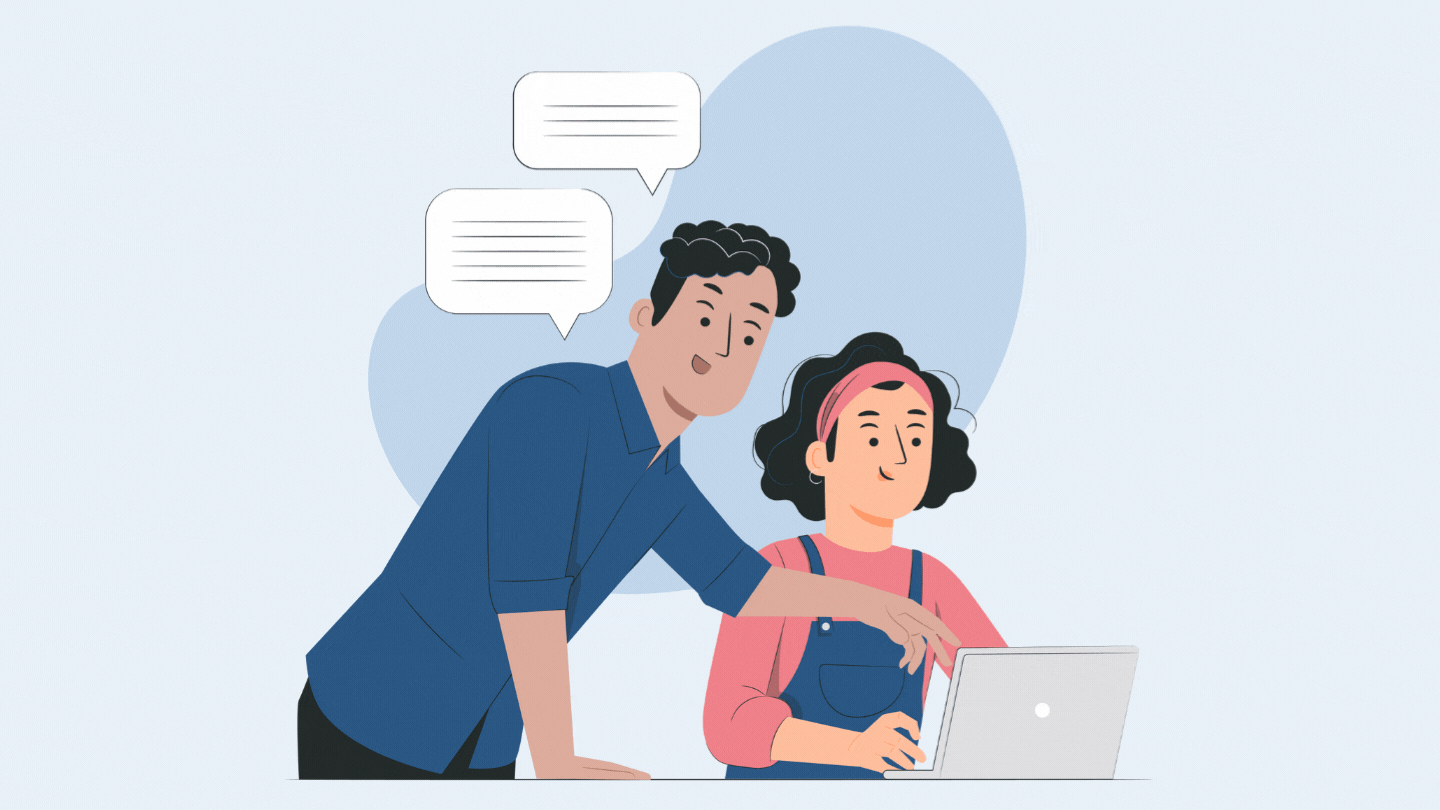
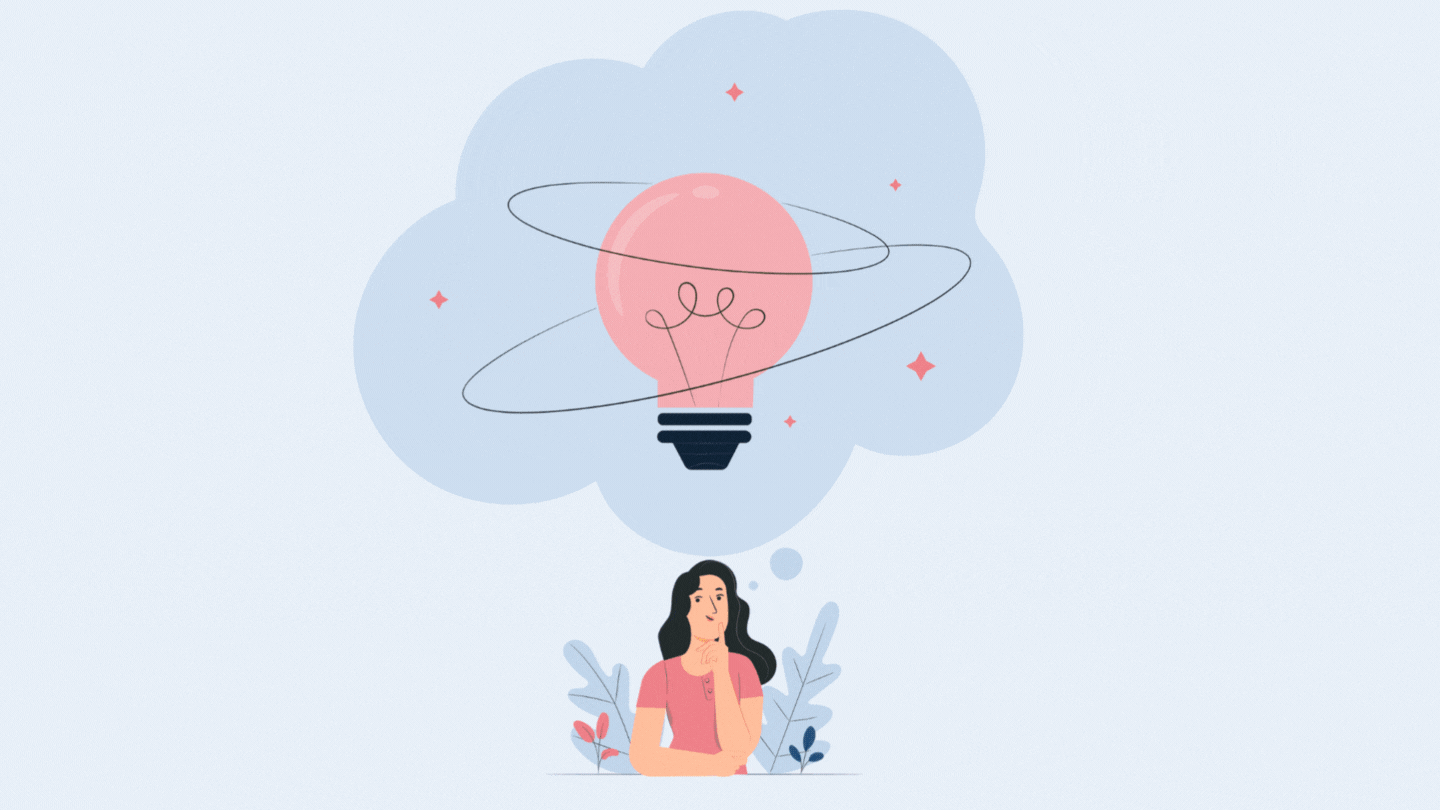
Une question ? Nos coachs sont à votre écoute !
/Story%201.png?width=378&height=326&name=Story%201.png)
Besoin de conseils sur votre projet ?
Carole et tous nos coachs entrepreneuriaux seront ravis de répondre à vos questions 🙂
Ils ont fait confiance à Captain Contrat
.png?width=96&height=96&name=image%201%20(2).png)


.png?width=96&height=96&name=image%202%20(1).png)

.png?width=96&height=96&name=image%203%20(2).png)
/Dissolution%203.png?width=96&height=96&name=Dissolution%203.png)

Nos soutiens de longue date


.jpeg?width=213&height=64&name=logo_lesechoslegal%20(1).jpeg)


.jpeg?width=213&height=64&name=logo_lesechoslegal%20(1).jpeg)
Découvrez les questions fréquentes d’autres entrepreneurs
-
📌 Qu’est-ce qu’un contrat à durée déterminée (CDD) ?
CDD est l’acronyme du Contrat à Durée Déterminée. Créé en 1979, il s’oppose au CDI, Contrat à Durée Indéterminée, qui est « la forme normale et générale de la relation de travail » en France. Le CDD représente donc une exception et c’est pour cette raison qu’il est sérieusement encadré par le droit du travail.
Le CDD est un contrat qui permet d’embaucher un salarié pour une durée limitée ou pour la réalisation d’une tâche précise et temporaire. L’emploi précaire que constitue le CDD ne peut donc avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.
Très encadré par la législation, le CDD impose des conditions de recours et formalités strictes à l’employeur. Le salarié en CDD dispose lui d’une législation et de conditions de recours plus souples qu’en CDI. Le droit du travail français impose une égalité de traitement entre les salariés sous contrats précaires.
Côté rémunération elle comprend le salaire ou traitement de base, ainsi que tous les autres avantages directes ou indirectes. De manière générale, le salarié en cdd bénéficie de la même rémunération que les salariés permanents, que ce soit au titre de la convention collective ou des usages en vigueur. Une indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu’une prime de précarité peuvent également être octroyés au salarié sous CDD.
Puisque le CDD est un contrat atypique, la violation des règles régissant le recours à ce type de contrat de travail entraîne le retour à la norme, et donc la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
-
Quels sont les motifs de recours au CDD ?
Les motifs de recours au CDD sont clairement définis par le code du travail.
Un employeur peut embaucher un salarié en CDD dans les cas suivants :
-
S’il doit remplacer un salarié : si ce salarié est absent ou que son contrat de travail a été suspendu par exemple. A noter que l’employeur n’est pas tenu d’affecter la personne recrutée aux exactes même tâches ;
-
Si l’entreprise connaît un accroissement temporaire de son activité. Commande exceptionnelle, travaux urgents, tout accroissement temporaire d’activité peut justifier l’emploi d’un CDD. Il n’est en revanche pas obligatoire que ce motif présente un caractère exceptionnel ou que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;
-
En cas de travail à caractère saisonnier ou s’il est défini par décret ou convention qu’il est d’usage de ne pas recourir au CDI. Le contrat saisonnier constitue le plus vieux contrat du monde. Il est surtout agricole ou touristique. La Loi Travail de 2016 propose une définition : il s’agit des activités dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction soit des saisons soit des modes de vie collectifs.
-
Pour le remplacement d’un chef d’entreprise, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
-
Pour le remplacement du chef d’une exploitation agricole ou de pisciculture (entre autres) ou une autre personne participant à l’activité de l’entreprise ;
-
Pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres pour la réalisation d’un objet défini, lorsqu’un accord de branche étendu le permet ;
-
Pour recruter certaines catégories de personnes sans emploi. Les séniors en sont un exemple ;
-
Si l’employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Ces conditions sont imposées par la Loi, un avocat peut vous conseiller et vous assurer que votre cas correspond ou non à l’un de ces critères.
-
-
Quelle est la durée maximale d’un CDD ?
Avant toute chose, et même si cela peut paraître évident, il convient de rappeler qu’un contrat à durée déterminée prend fin lorsqu’il arrive à son terme.
Contrairement aux idées reçues, la durée maximale d’un CDD peut dans certains cas excéder 18 mois.
En effet, selon le type de contrat (terme précis ou sans terme précis) et la justification d’emploi d’une personne en CDD, cette durée maximale peut varier.
Pour les CDD à date d’échéance définie :
-
18 mois : durée maximale de la plupart des CDD ;
-
9 mois : lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'arrivée d'un salarié recruté en CDI ;
-
24 mois si le contrat est exécuté à l'étranger, s'il est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié avant la suppression de son poste ou en cas d'accroissement exceptionnel d'activité.
Dans certains cas, un CDD sans terme précis peut être mis en place. Dans ce cas, la durée maximale du CDD peut durer :
-
Jusqu'au retour du salarié remplacé
-
Jusqu'à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
-
-
Existe-t-il une période d’essai pour les CDD ?
Oui, le CDD peut comporter une période d’essai.
Sauf usages ou conventions qui prévoient des durées moindres, le calcul de la période d’essai se fait ainsi : 1 jour de période d’essai par semaine de CDD.
Cette durée ne peut excéder :
-
2 semaines pour les CDD de 6 mois ou moins
-
1 mois pour les CDD de plus de 6 mois
Pour les CDD sans terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
-
-
Combien de fois puis-je renouveler le CDD d’un de mes salariés ?
Un contrat à durée déterminée (CDD) peut être renouvelé par avenant sous certaines conditions. Un CDD n'est renouvelable que 2 fois et dans la limite d'une durée maximale.
CDD à terme précis
Si le CDD prévoit un terme (date d'échéance précise), il ne peut être renouvelé que 2 fois. Dans ce cas, le renouvellement est possible soit :
- Parce qu'une clause du contrat le prévoit,
- Parce qu'un avenant est proposé au salarié avant l'échéance de son contrat.
Le renouvellement du CDD est possible sous réserve que la durée totale du CDD (y compris son renouvellement) ne dépasse pas la durée maximale autorisée :
- 18 mois dans la plupart des cas,
- ou 9 mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'arrivée d'un salarié recruté en CDI,
- ou 24 mois si le contrat est exécuté à l'étranger, s'il est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié avant la suppression de son poste ou en cas d'accroissement exceptionnel d'activité.
Lorsque le contrat se poursuit après l'échéance du terme du CDD, il se transforme automatiquement en CDI et le salarié conserve l'ancienneté acquise pendant son CDD. Le non-respect des conditions de renouvellement entraîne la requalification du CDD en CDI.
CDD sans terme précis
Il est possible de signer un CDD sans terme précis dans les cas suivants :
- remplacement d'un salarié absent,
- remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu,
- attente de l'arrivée d'un salarié recruté en CDI,
- recrutement de salariés saisonniers,
- remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une activité libérale,
- remplacement du chef d'une exploitation agricole.
Dans ces cas, le CDD est conclu pour une période minimale (qui doit être précisée au sein du contrat). Il peut durer :
- jusqu'au retour du salarié remplacé,
- ou jusqu'à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Le non-respect des conditions de renouvellement entraîne la requalification du CDD en CDI.
-
Le CDD de mon salarié vient de s’achever, puis-je immédiatement conclure avec lui un autre CDD ?
Non, il n’est pas possible d’avoir recours aux « CDD successifs » pour un même poste, au risque de voir le CDD requalifié en CDI. Un délai de carence doit être respecté.
Ce délai de carence est égal à :
-
Un tiers de la durée du contrat expiré – pour les contrats de plus de 14 jours*, renouvellements inclus
-
La moitié de de la durée du contrat expiré – pour les contrats de moins de 14 jours*, renouvellements inclus. (*Les jours pris en compte sont ceux d’ouverture de l’entreprise)
-
-
Mon salarié en CDD commet une faute grave, son licenciement est-il possible ?
Oui, un employeur peut licencier un salarié en CDD pour faute grave. On parle alors de « rupture anticipée du CDD », le terme « licenciement » étant réservé aux CDI. L’employeur qui rompt doit respecter la procédure contradictoire, puis être en mesure de prouver la faute grave du collaborateur qui devra être rappeler dans la lettre de rupture.
L’employeur se doit alors de respecter scrupuleusement les procédures en place. Ces procédures sont semblables à celles du licenciement pour faute grave (CDI).
L’employeur se doit de :
-
Convoquer le salarié en CDD ;
-
Notifier le salarié en CDD : le contenu de cette lettre de notification a une très grande importance. En cas de procès aux prud’hommes, seuls les motifs évoqués dans cette lettre seront pris en compte par les juges. Un avocat saura vous conseiller et vous accompagner dans l’élaboration de cette lettre.
En cas de faute grave avérée du salarié, l’employeur :
-
N’est pas tenu de verser les indemnités de fin de contrat ;
-
N’est pas tenu de verser l’indemnité compensatrice pour le préavis ;
-
Est tenu de verser l’indemnité de précarité de la première partie de CDD si la faute a été découverte pendant une période de renouvellement ;
-
Est tenu de verser l’indemnité compensatrice de congés payés.
-
-
Un salarié en CDD à temps partiel a-t-il les mêmes droits que les autres au sein de l’entreprise ?
Un salarié en CDD à temps partiel a les mêmes droits que les autres salariés au sein de l’entreprise.
Ainsi, la durée de sa période d’essai ne peut être supérieure à celle d’un salarié à temps plein (elle est calculée de la même façon) ; sa rémunération doit être proportionnelle à celle d’un salarié à temps complet avec la même qualification et au même poste, etc.
Soulignons néanmoins que, dans certains cas, le salarié en CDD à temps partiel peut cumuler plusieurs emplois (à ce propos, voir question 3).
-
Mon salarié me dit avoir trouvé un CDI alors qu’il est actuellement en CDD, a-t-il le droit de quitter son poste ?
Oui, un salarié en CDD ayant trouvé un CDI peut rompre le CDD avant l’échéance du terme. Le salarié devra fournir à son employeur un justificatif (promesse d'embauche en CDI ou contrat de travail).
Sauf accord salarié-entreprise, le salarié doit respecter un préavis dont le calcul de la durée se fait ainsi : 1 jour par semaine réalisée au sein de l’entreprise, compte tenu de :
-
La durée totale du contrat, renouvellement inclus si le CDD a un terme précis
-
La durée effectuée si le CDD n’a pas de terme précis.
Dans les deux cas, le préavis ne peut excéder deux semaines.
-
-
Comment obtenir un contrat à durée déterminée ?
-
Vous répondez au questionnaire relatif au CDD sur notre site
-
Nous vous mettons en relation avec un avocat spécialisé en droit social qui vous conseille et répond à vos questions par téléphone
-
L’avocat rédige votre CDD, personnalisé et adapté à votre salarié et votre entreprise
-



/img%2Bmock-up-hors_crea_1-desktop.png?width=494&name=img%2Bmock-up-hors_crea_1-desktop.png)