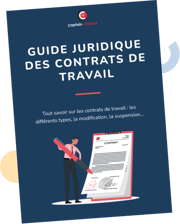Le CDI : un contrat sûr pour vos salariés
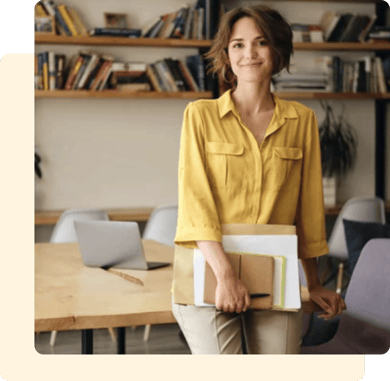


Qu’est-ce qu’un CDI ?
CDI signifie Contrat à Durée Indéterminée. C’est un contrat sans limitation de durée, mais il ne s’agit évidemment pas d’un engagement perpétuel, puisque chacune des parties peut y mettre un terme en respectant certaines conditions. Le CDI est, en France, la forme normale et générale du contrat de travail entre un employeur et un salarié. Le CDI peut être à temps plein ou à temps partiel.
Pourquoi rédiger un CDI ?
La rédaction d'un CDI a lieu lorsqu'une entreprise souhaite intégrer, pour une durée indéterminée, un nouveau membre à ses équipes. Établir un contrat écrit n’est pas une obligation (hors CDI intermittent). Cependant, la rédaction du contrat et la signature de celui-ci par les deux parties sont largement recommandées pour une protection évidente à la fois du salarié et de l’employeur.
Gagnez du temps dans vos démarches
- Se renseigner sur ses droits et obligations en tant qu’employeur
- Rédiger le contrat de travail en incluant les clauses essentielles
- Ne surtout oublier aucune clause importante
- Bénéficier de la recommandation d’un avocat expert dans son secteur d’activité
- Obtenir un rendez-vous avec un lui dans la journée
- Profiter de conseils illimités et sur-mesure
- Être sûr de la sécurité du contrat fournit à votre salarié
- Sécurité juridique
- Sérénité d’esprit
- Gain de temps
- Accompagnement illimité (message et téléphone)
- Meilleur rapport qualité - prix qu’un avocat traditionnel ou qu’un expert-comptable
- Temps passé à se renseigner sur les clauses indispensables et sur celles à proscrire
- Temps passé à rédiger le contrat de travail
- Risques de litiges avec votre salarié élevé qui peut générer de grosses pertes financières
Aucun, vous êtes satisfait ou remboursé !
Les 4 étapes pour obtenir votre CDI
🚀 Vous développez votre activité, nous gérons votre juridique !
1. Questionnaire en ligne
Notre questionnaire permet de comprendre votre besoin. Commencer
2. Échange téléphonique
Notre coach choisira l'avocat le plus adapté à votre situation.
3. Appel et obtention du devis
Après un échange gratuit, l'avocat vous propose un devis forfaitaire.
4. Échanges illimités
Votre avocat réalise votre prestation.
Vous êtes entre de bonnes mains
Nos avocats partenaires proposent un forfait personnalisé pour chaque dossier à un tarif préférentiel, fixe, sans frais additionnel, pour un projet sans mauvaise surprise.

Votre avocat assure une première prise de contact et l'envoi d'un devis sous 24h. Vos échanges sont sécurisés et illimités pour garantir la réalisation de la prestation sous 72h.
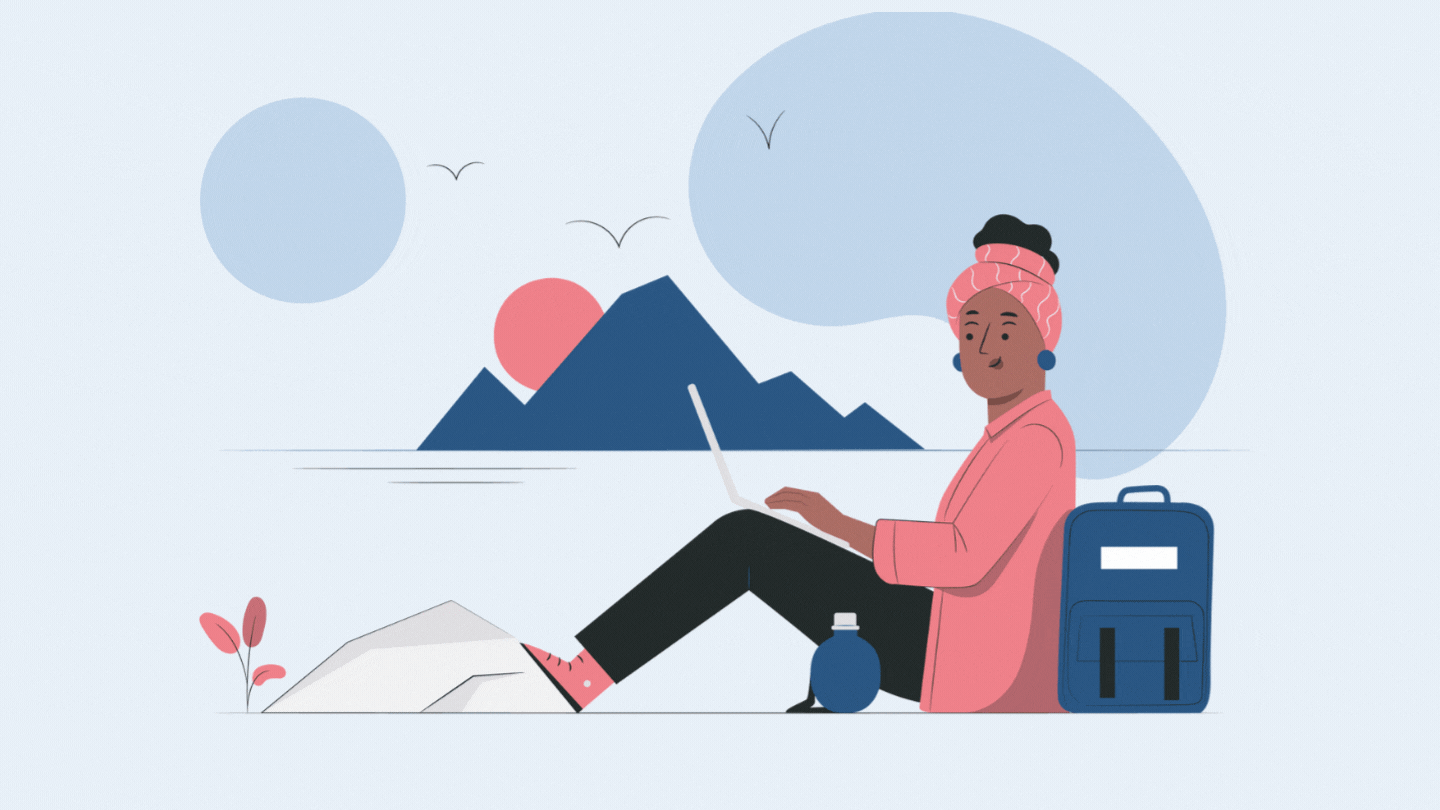
Nos avocats partenaires sélectionnés répondent à chaque besoin juridique grâce à leur expertise sur les différents secteurs d'activités.
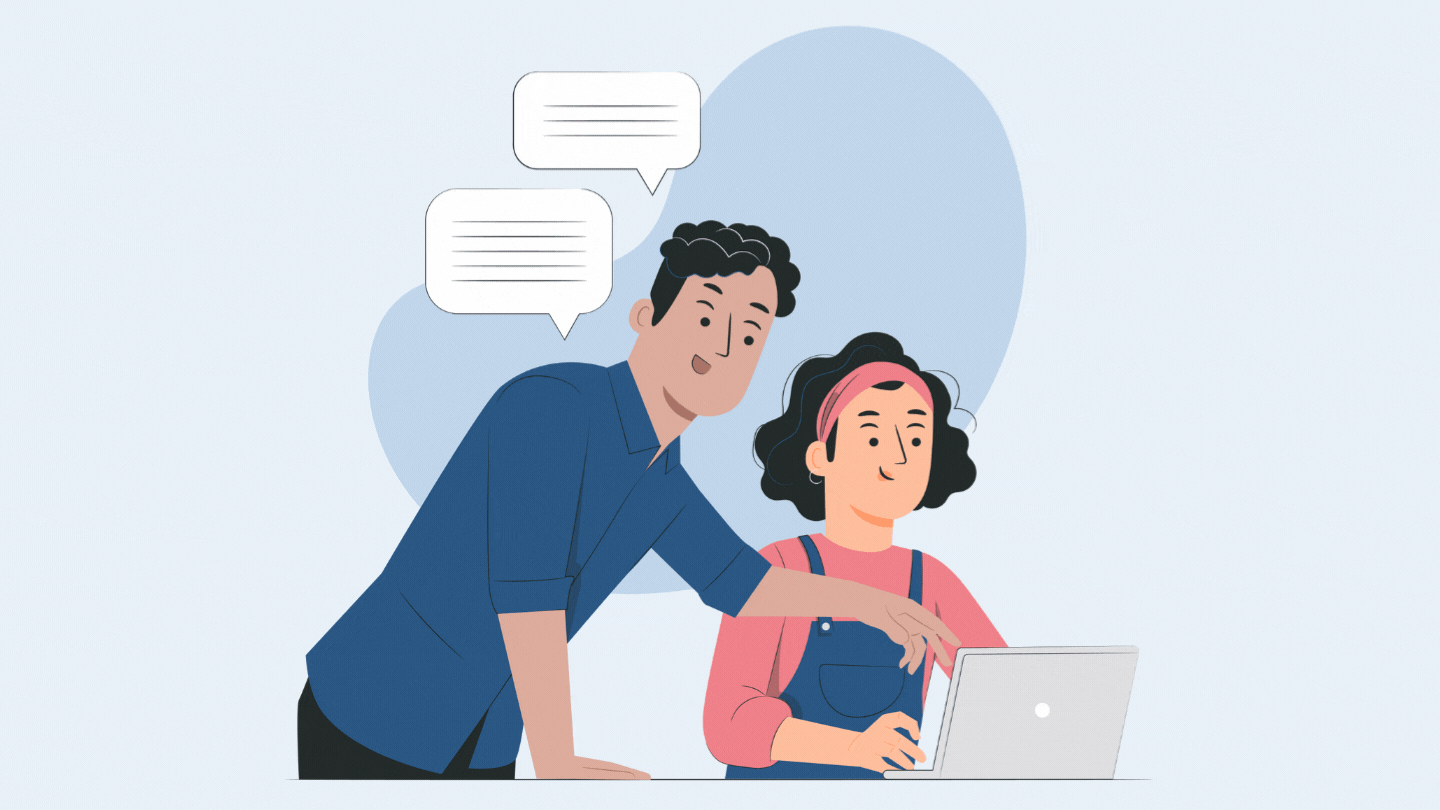

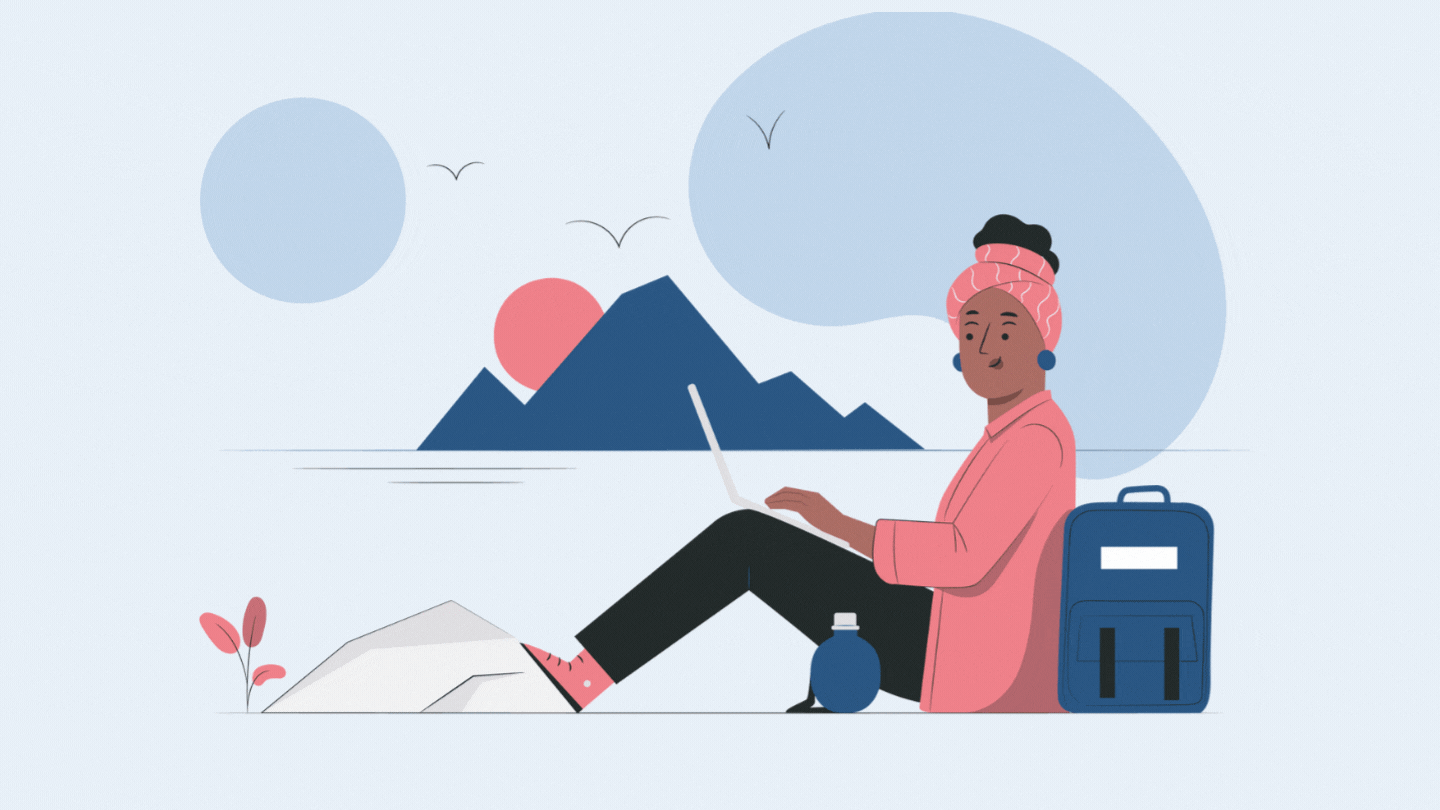
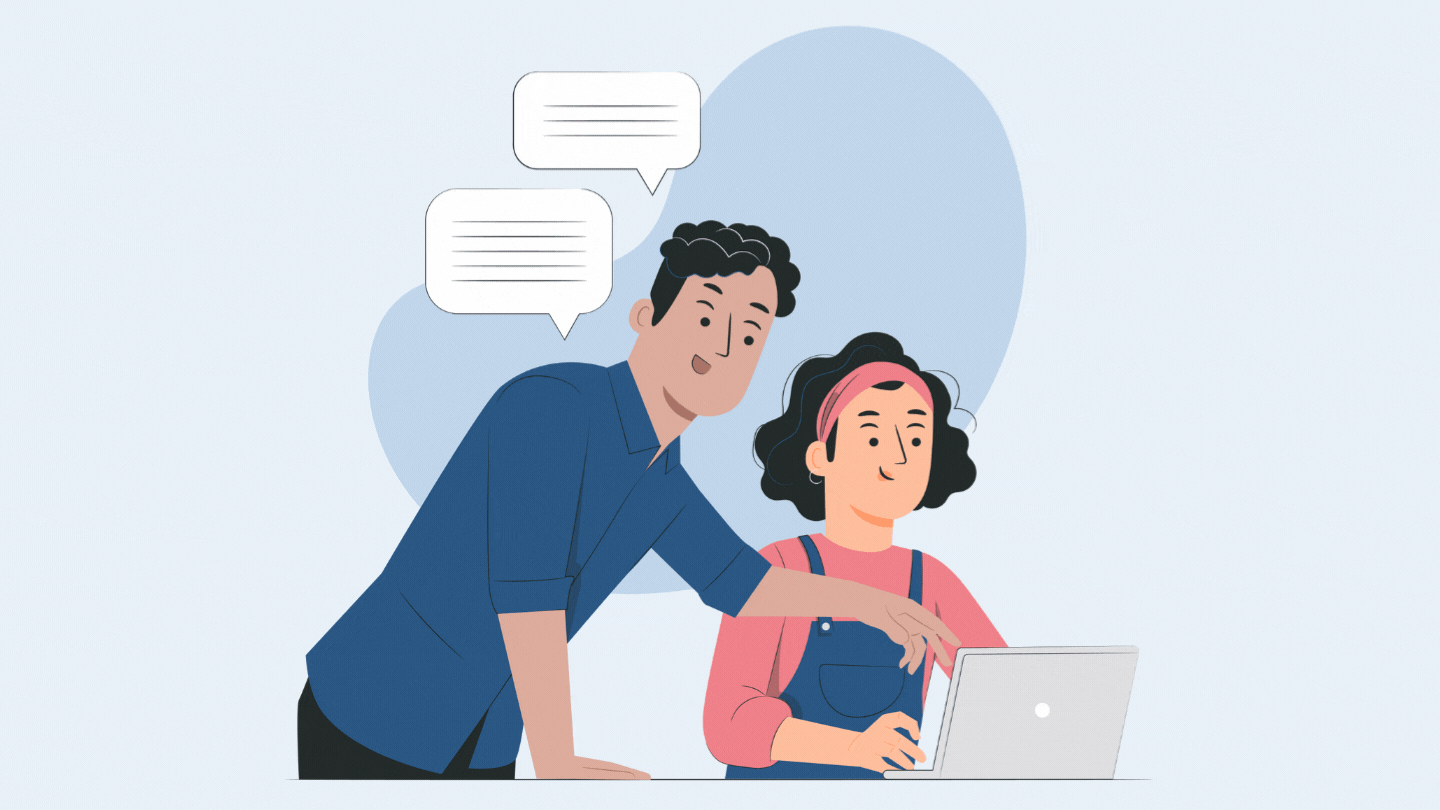
Une question ? Nos coachs sont à votre écoute !
/Story%201.png?width=378&height=326&name=Story%201.png)
Besoin de conseils sur votre projet ?
Carole et tous nos coachs entrepreneuriaux seront ravis de répondre à vos questions 🙂
Ils ont fait confiance à Captain Contrat



.png?width=96&height=96&name=image%201%20(2).png)

.png?width=96&height=96&name=image%202%20(1).png)
.png?width=96&height=96&name=image%203%20(2).png)

Nos soutiens de longue date


.jpeg?width=213&height=64&name=logo_lesechoslegal%20(1).jpeg)


.jpeg?width=213&height=64&name=logo_lesechoslegal%20(1).jpeg)
Tout comprendre sur le contrat à durée indéterminée
/Photo%20(1).png?width=64&height=64&name=Photo%20(1).png)
Diplômée d'un Master II en Droit des affaires (Panthéon-Sorbonne), Sofia a travaillé en cabinet d'avocats et Maison d'édition juridique. Après avoir développé sa plume, elle a rejoint Captain Contrat pour vous proposer des contenus fiables et accessibles.
SOMMAIRE :
- Quelles clauses obligatoires pour un CDI ?
- Puis-je partir d'un modèle pour rédiger un CDI ?
- Existe-t-il différents types de CDI ?
- Quels documents pour la rédaction d'un CDI ?
- Quelle durée pour la période d'essai ?
- Est-il possible de renouveler une période d'essai ?
- Quels sont les avantages d'un CDI ?
- Quels sont les inconvénients d'un CDI ?
- Le CDI à temps partiel existe-t-il ?
- Rompre un CDI : pourquoi ?
/Photo%20(1).png?width=64&height=64&name=Photo%20(1).png)
Diplômée d'un Master II en Droit des affaires (Panthéon-Sorbonne), Sofia a travaillé en cabinet d'avocats et Maison d'édition juridique. Après avoir développé sa plume, elle a rejoint Captain Contrat pour vous proposer des contenus fiables et accessibles.
Quelles sont les clauses obligatoires d'un CDI?
Voici les éléments qui doivent apparaître obligatoirement sur un CDI :
- La fonction occupée par le salarié ;
- La durée et les conditions de renouvellement de la période d’essai le cas échéant (la période d’essai n’est pas obligatoire)
- Les qualifications professionnelles du salarié
- Le délai du préavis en cas de départ du salarié
Puis-je partir d'un modèle pour rédiger un CDI?
Partir d’un modèle de contrat comporte malheureusement plusieurs risques
- Le modèle type peut être mal adapté et ne pas mal refléter les spécificités de l’emploi, il ne comporte notamment aucune clause spéciale.
- Le modèle choisi peut tout simplement ne pas respecter le code du travail, vous n’avez aucune garantie en termes de sécurité juridique.
- Le modèle peut enfin ne pas respecter la convention collective de votre entreprise dont les spécificités ne sont généralement pas incluses.
Existe-t-il différents types de CDI?
Oui, il existe bien différents types de CDI que vous pouvez choisir de proposer en fonction de vos besoins et de votre situation :
- Le CDI intérimaire qui permet à un intérimaire de sécuriser son parcours professionnel avec des missions plus longues.
- Le CDI intermittent qui permet à un salarié d’alterner périodes travaillées et non travaillées. En tant qu’entreprise, elle répond à des besoins d’activité fluctuante en fonction des années.
- Le CDI de chantier qui est aussi appelé de mission ou contrat d’opération, est un contrat par lequel l’employeur embauche un salarié en vue de l’affecter à la réalisation de travaux dont la date de fin n’est pas connue.
Quelle est la liste des documents à fournir pour la rédaction d'un CDI?
Il n’y a pas d’obligations légales concernant la liste des documents à fournir pour un contrat de travail à durée indéterminée.
Le plus souvent, le salarié devra remettre à l’employeur :
- Une copie de la pièce d’identité recto verso en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport, un titre de séjour ou une autorisation de travail) ;
- Une copie d’attestation d’affiliation à la Sécurité sociale ou photocopie de la carte vitale recto verso ;
- Un relevé d’identité bancaire (RIB) pour le versement du salaire ;
- Un justificatif de transport.
L’employeur transmet obligatoirement :
- Une copie du contrat de travail ;
- Un livret d’épargne salariale, le cas échéant ;
- Une notice d’information concernant les textes de conventions applicables au sein de l’entreprise.
Quelle est la durée d'une période d'essai avant la conclusion définitive d'un CDI?
Selon l’article L. 1221-10 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
- Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
- Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
- Pour les cadres, de quatre mois.
Est-il possible de renouveler une période d'essai dans un CDI?
La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche le prévoit. La possibilité de renouvellement doit figurer dans le contrat de travail. L’article L. 1221-21 du Code du travail précise que la durée de la période d’essai, incluant un renouvellement, ne doit pas dépasser :
- Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
- Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
- Huit mois pour les cadres.
Quels sont les avantages d'un CDI?
L’employeur et le salarié bénéficient grâce au CDI de la stabilité et de la sécurité juridique. Voici la liste d’avantages :
Pour l’employeur :
- Le coût : pour un CDD ou contrat d'intérim, des primes de précarité doivent être versées.
- Le salarié est soumis à une obligation de loyauté. Une clause de non-concurrence peut être insérée dans le contrat de travail.
Pour le salarié :
- Le CDI assure un revenu fixé à l’avance et régulier au salarié, lui permettant notamment les emprunts bancaires.
- Il dispose de congés payés (30 jours au minimum pour une année).
Quels sont les inconvénients d'un CDI?
Le CDI impose un engagement sur le long terme pour les deux parties.
Pour l’employeur :
- Il s’engage dans une relation de travail sur le long terme. Des risques peuvent survenir : mauvais recrutement, etc.
Pour le salarié :
- La période d’essai dont la durée est variable selon les fonctions occupées.
- Pour mettre fin au contrat unilatéralement, le salarié doit démissionner. Il ne percevra pas d’indemnités chômage.
- Il peut solliciter une rupture conventionnelle auprès de son employeur, mais ce dernier peut refuser.
Le CDI à temps partiel existe-t-il?
Le CDI à temps partiel se rapproche grandement du CDI à temps plein par le niveau de rémunération et les garanties qu’il offre (congés payés, arrêt maladie, etc).
En principe, le CDI à temps partiel ne permet pas d’effectuer des heures supplémentaires, mais la loi autorise ce que l’on appelle des heures complémentaires. La différence tient au fait que cette heure travaillée en plus vous sera facturée au même tarif qu’une heure normale.
Ainsi, ce type de contrat vous permet de réguler la durée de temps de travail en fonction des besoins de l’entreprise.
Les salariés dits « à temps partiel » doivent effectuer une durée de travail inférieure à la durée légale, soit moins de 35 heures par semaine. La durée de travail peut varier conventionnellement selon la branche ou l’entreprise, pour la durée mensuelle. Pour une durée de travail annuelle, le travailleur à temps partiel est celui qui effectue en général moins de 1607 heures, ou moins que la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise.
Quels sont les différents cas de ruptures possibles du CDI?
Le contrat à durée indéterminée (CDI) peut être rompu à tout moment.
Rupture à l'initiative de l’employeur
- Durant la période d’essai, sans motif particulier ;
- Après la période d’essai, licenciements pour motif personnel ou économique ;
- Mise à la retraite d’office.
Rupture à l’initiative du salarié
- Durant la période d’essai, sans motif particulier ;
- Démission ;
- Départ volontaire à la retraite ;
- Résiliation judiciaire (rupture demandée au conseil de prud’hommes) ;
- Prise d’acte (mode de rupture du contrat par décision de justice).
Rupture d’un commun accord
- Rupture conventionnelle.




/img%2Bmock-up-hors_crea_1-desktop.png?width=494&name=img%2Bmock-up-hors_crea_1-desktop.png)