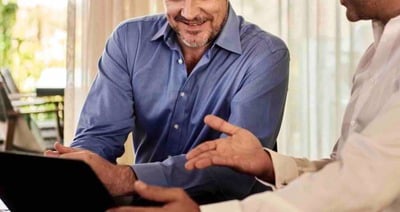- Les arrhes permettent au consommateur de réserver un bien ou un service tout en lui laissant la possibilité d’annuler sa commande.
- L’acompte constitue un premier paiement ferme sur le prix d’un bien ou d’une prestation. Il engage définitivement l’acheteur et le vendeur.
- En cas d’annulation, les conséquences pour le consommateur et le professionnel ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agisse d’arrhes ou d’acompte.
- Quelle est la différence entre arrhes et acompte ?
- Quelles sont les différences juridiques entre arrhes et acompte ?
- Comment savoir si vous avez versé des arrhes ou un acompte ?
- Que faut-il choisir entre acompte, arrhes, avance et avoir ?
- Arrhes ou acompte : exemples concrets
- Que faire en cas de litige concernant un acompte ou des arrhes ?
Quelle est la différence entre arrhes et acompte ?
Quelle est la définition des arrhes ?
Les arrhes correspondent à une somme versée à l’avance lors de l’achat d’un bien ou d’une prestation de services. Elles représentent un engagement souple : ni le client, ni le professionnel ne sont obligés d’aller jusqu’au bout du contrat.
Qu'est-ce qu'un acompte ?
L’acompte est un premier versement ferme sur le prix total d’un bien ou d’un service. Il engage définitivement les deux parties : le vendeur doit livrer le produit ou réaliser la prestation et l’acheteur doit payer le reste du montant convenu.
Le montant de l’acompte n’est pas fixé par la loi : le professionnel peut le déterminer librement. Ce montant doit être mentionné dans le contrat.
Quelles sont les différences juridiques entre arrhes et acompte ?
Quelles sont les conséquences en cas d'annulation ou de rétractation ?
En cas d'annulation par le consommateur
Le consommateur a versé des arrhes : il peut annuler son achat, mais il perd la somme qu’il a versée. Aucun remboursement n’est dû par le professionnel, sauf si le contrat le prévoit expressément ou que le consommateur bénéficie d’un droit de rétractation.
Le consommateur a versé un acompte : il ne peut pas annuler la vente ou la prestation. S’il se rétracte sans motif légitime, il doit payer le solde (sauf droit légal de rétractation). Le professionnel peut aussi réclamer des dommages et intérêts pour rupture du contrat.
En cas d'annulation par le professionnel
Le consommateur a versé des arrhes : si le vendeur ou le prestataire annule la vente, il doit rembourser le double des arrhes. Par exemple, si le consommateur a versé 200 €, le professionnel devra lui restituer 400 €.
Si le consommateur a versé un acompte : le professionnel est tenu d’exécuter le contrat.
S’il se rétracte, l’acheteur peut exiger la livraison (exécution forcée) ou réclamer des dommages et intérêts. Le simple remboursement de l’acompte ne suffit pas à réparer le préjudice causé.
Vous vous inscrivez à un atelier de cuisine au prix de 200 € et versez 50 € d’arrhes.
- Si vous décidez de ne pas y participer, vous perdez les 50 €, mais vous n’avez aucune autre obligation ;
- Si l’organisateur annule l’atelier, il doit vous rembourser 100 € (le double des arrhes).
Si vous aviez versé 50 € d’acompte :
- Vous êtes engagé et devez payer le solde pour confirmer votre inscription, sauf motif légitime ;
- Si l’organisateur annule l’atelier, il doit rembourser les 50 € que vous avez versés. Vous pouvez en plus lui réclamer une compensation financière si vous subissez un préjudice supplémentaire (par exemple des frais engagés pour le déplacement ou l’achat d’ingrédients).
Quand le remboursement est-il possible ?
Le remboursement des arrhes ou de l’acompte n’est possible que si le consommateur bénéficie d’un droit de rétractation. Cela concerne uniquement :
- les achats à distance (internet, téléphone, courrier) ;
- le démarchage à domicile.
Dans ce cas, le consommateur dispose d’un délai légal de 14 jours à compter de la réception du bien ou de la conclusion du contrat pour annuler son achat. L’acompte comme les arrhes lui sont intégralement remboursés.
En revanche, pour un achat en magasin ou un produit personnalisé/sur mesure, le consommateur ne peut en principe pas récupérer l’acompte ou les arrhes en cas d’annulation. Le remboursement n’est possible que si le professionnel le prévoit explicitement, par exemple dans le cadre d’un geste commercial ou d’une politique de retour.
Comment savoir si vous avez versé des arrhes ou un acompte ?
Vérifier les termes utilisés dans le contrat
Il faut lire attentivement le contrat, le bon de commande ou les conditions générales de vente. L’utilisation des termes « acompte » ou « arrhes » détermine vos droits et obligations.
Vous devez aussi prendre le temps de comprendre les clauses relatives à l’annulation. Sans utiliser les mots « arrhes » ou « acompte », le contrat peut spécifier que :
- vous devez payer le solde même en cas d’annulation, ce qui correspond juridiquement à un acompte ;
- vous pouvez vous rétracter en perdant uniquement la somme versée, ce qui correspond à des arrhes.
Que faire si le contrat ne précise rien ?
Si le contrat ne mentionne ni acompte, ni arrhes, ni conditions d’annulation, alors la somme versée à l’avance est présumée être des arrhes.
Que faut-il choisir entre acompte, arrhes, avance et avoir ?
Quand privilégier l'acompte ?
L’acompte engage définitivement les deux parties : le professionnel doit fournir le bien ou service et le consommateur doit payer le solde.
Cette solution est adaptée :
- pour des biens ou services coûteux ou en volume important ;
- pour des produits personnalisés ou sur mesure (meubles, créations, commandes spécifiques) ;
- pour des transactions où l’annulation par le consommateur peut avoir des conséquences financières, car le produit est difficilement revendable.
Quand opter pour des arrhes ?
Le consommateur peut se rétracter, mais cette somme ne lui sera pas remboursée. Si c'est le vendeur qui annule, celui-ci doit rembourser le double des arrhes au consommateur.
Cette solution est adaptée :
- pour financer la production ou l’achat des matières premières ;
- pour des produits ou services peu coûteux ou facilement revendables.
Quand choisir l'avance ?
L’avance est une somme versée avant la réalisation d’un bien ou d’une prestation, sans précision sur sa nature (acompte ou arrhes). Juridiquement, elle est assimilée aux arrhes, sauf pour les biens sur mesure ou immobiliers.
Comme pour les arrhes, le vendeur peut donc demander une avance :
- s’il a besoin de fonds immédiats pour produire le bien ;
- si le produit ou service est peu coûteux ou peut être facilement revendu.
Quand opter pour un avoir ?
L’avoir correspond à la valeur d’un produit que le client rend au vendeur. Il permet au consommateur de réaliser un nouvel achat auprès du même vendeur pour un montant équivalent. L’avoir est généralement valable 1 an.
Notez que :
- si le vendeur n’est pas en tort (pas de produit défectueux ni de livraison tardive), la loi ne l’oblige pas à proposer un avoir ;
- si le vendeur est en tort, il doit en principe rembourser directement le client. Celui-ci n’est pas obligé d’accepter un avoir.
Le vendeur peut proposer un avoir :
- en cas d’erreur de commande ;
- pour échanger un produit contre un autre ;
- lorsque le client ne souhaite pas être remboursé ;
- pour maintenir une bonne relation commerciale avec le client.
|
Type de versement |
Effet sur l’engagement |
Annulation par le consommateur |
Annulation par le professionnel |
Quand le privilégier ? |
|
Acompte |
Engagement ferme des deux parties |
Somme perdue (sauf clause relative au droit de rétractation) |
Exécution forcée ou indemnisation |
|
|
Arrhes / Avance |
Liberté de rétractation |
Somme perdue |
Remboursement du double |
|
|
Avoir |
Pas d’engagement ferme |
Avoir possible uniquement si le vendeur accepte |
Remboursement obligatoire |
|
Arrhes ou acompte : exemples concrets
Cas n° 1 : achat d'un bien en magasin
Un client souhaite acheter un téléviseur à 1 000 € en magasin, mais le produit n’est pas en stock. Le vendeur doit donc le commander auprès de son fournisseur. Il demande un acompte de 200 € au client.
Cet acompte engage fermement les deux parties : le client doit payer le solde à la livraison et le magasin doit commander et fournir le produit.
Si le client annule sa commande, il perd l’acompte. Si le magasin annule, il doit rembourser les 200 € et peut être tenu d’indemniser le client pour le préjudice subi.
Cas n° 2 : réservation d'une prestation de service
Un client commande des travaux de peinture à un artisan. Leu valeur totale s’élève à 3 000 €. Le client verse 300 € d’arrhes pour réserver la prestation.
En cas d’annulation par le client, cette somme est perdue. Si le prestataire annule, il doit rembourser le double, soit 600 €.
Cas n° 3 : location de vacances
Un locataire réserve un appartement de vacances pour 1 200 € la semaine. Il verse un acompte de 400 € pour confirmer sa réservation.
Si le locataire annule, l’acompte n’est pas remboursé. Si le propriétaire annule, il doit restituer les 400 € et peut être tenu de compenser tout préjudice subi par le locataire.
Que faire en cas de litige concernant un acompte ou des arrhes ?
Les démarches amiables
Vous devez d’abord tenter de trouver une solution amiable. Il faut contacter l’autre partie pour trouver un arrangement (avoir, échelonnement du paiement ou annulation du contrat par exemple).
Les recours judiciaires
Si aucun accord n’est trouvé, il faut envoyer une lettre de mise en demeure avec accusé de réception à l’autre partie. Dans ce courrier vous réclamez le paiement ou le remboursement des arrhes ou de l’acompte.
En cas d’échec de la mise en demeure, vous pouvez saisir le tribunal compétent (tribunal de proximité ou judiciaire selon le montant du litige).
Quels sont les justificatifs à conserver ?
Vous devez conserver tous les documents liés à la transaction commerciale :
- Contrat ou conditions générales de vente ;
- Bon de commande ;
- Factures et preuves de paiement (reçus, virements, tickets de caisse) ;
- Échanges écrits avec le professionnel ou le client (emails, messages, courriers) ;
- Documents relatifs au produit ou à la prestation (photos, devis, fiches techniques) ;
- Justificatifs d’expédition ou de livraison si applicables.
FAQ
-
📌 Un acompte est-il toujours remboursable ?
Non. L’acompte est un paiement ferme. Si le consommateur annule, il ne peut pas récupérer son acompte (sauf disposition particulière dans le contrat ou droit légal de rétractation). Si le professionnel annule, il doit rembourser le consommateur (avec une compensation supplémentaire si le client en demande une).
-
Les arrhes sont-elles toujours perdues en cas de désistement ?
Oui, si le consommateur annule sa commande, il ne peut pas récupérer les arrhes. Si le professionnel annule, il doit rembourser le double des arrhes au client.
-
Quelle est la différence entre un acompte et une avance ?
L’acompte engage fermement les deux parties. L’avance est juridiquement assimilée aux arrhes.
-
Peut-on facturer plusieurs acomptes pour une même commande ?
Oui, tant que cela est prévu dans le contrat et que chaque acompte est clairement identifié.
-
Quel montant demander en arrhes ou en acompte ?
La loi ne fixe pas le montant des arrhes et des acomptes. Le professionnel est libre d’en déterminer le montant. Il s’agit généralement d’un pourcentage du prix total.
-
Que se passe-t-il si le contrat ne précise pas la nature du versement ?
La somme versée est présumée être des arrhes.
-
Un acompte est-il encaissé immédiatement ?
Oui, l’acompte est versé et encaissé au moment de la signature ou de la commande.
Entreprendre.service-public.fr, Fiche pratique Acompte, avance, arrhes et avoir : quelles différences ?
Légifrance, Article 1590 du Code civil
Légifrance, Articles L214-1 à L214-3 du Code de la consommation
- Mise à jour du 6 novembre 2025 : vérification des informations comptables.