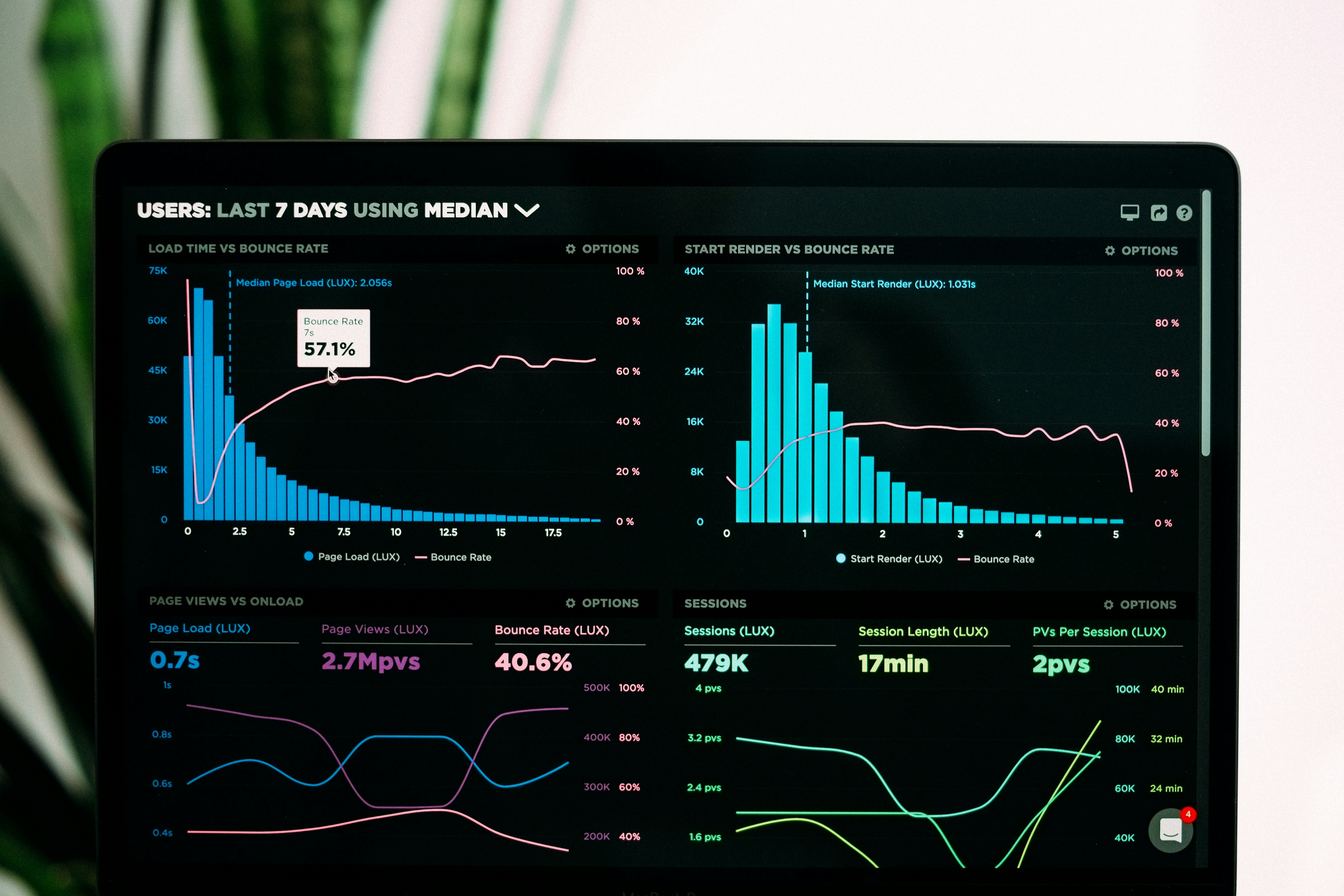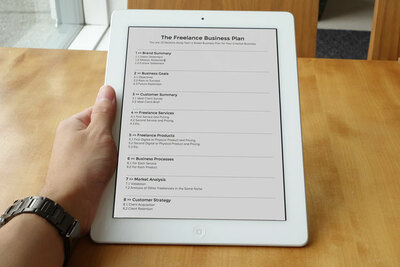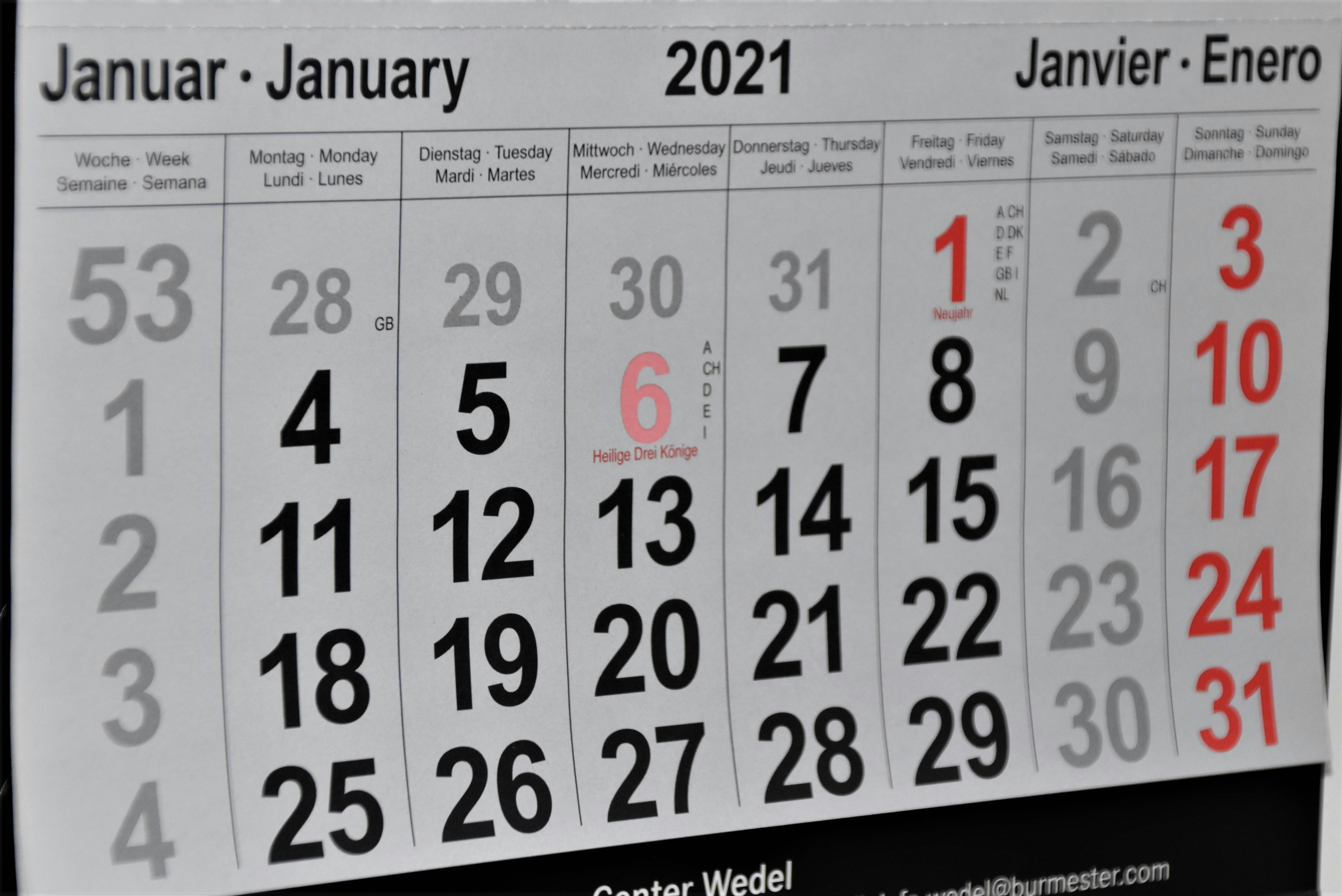- Le bilan fonctionnel se base sur le bilan comptable et classe les données en 2 catégories : les emplois et les ressources.
- Réaliser un bilan fonctionnel permet de connaître la santé financière d’une entreprise et d’avoir une vision à court et long terme.
- À la différence du bilan comptable, le bilan fonctionnel n'est pas obligatoire.
Qu'est-ce que le bilan fonctionnel ?
Le bilan fonctionnel est un tableau regroupant les données du bilan comptable réalisé en fin d’exercice. Mais cette fois, l’organisation des chiffres est différente pour mieux appréhender l’équilibre économique de l’entreprise.
Quand on parle d’actif et de passif dans un bilan comptable, le bilan fonctionnel classe les éléments en deux catégories :
- les emplois ;
- les ressources.
Tableau de bilan fonctionnel
|
Emplois |
Ressources |
|
Emplois stables :
|
Ressources stables :
|
|
Actifs circulants :
|
Passif circulant :
|
|
Trésorerie active
|
Trésorerie passive
|
Quels sont les éléments composants le bilan fonctionnel ?
Les emplois (partie gauche du tableau)
Les emplois représentent l’utilisation des ressources financières de l’entreprise. Ils montrent où et comment les fonds ont été investis ou immobilisés pour assurer le fonctionnement et le développement de l’activité. Autrement dit, les emplois traduisent la destination des capitaux : ce sont les moyens mis à la disposition de l’entreprise pour produire, vendre et se développer.
Dans cette partie du tableau, on retrouve les éléments suivants :
- les emplois stables : il s’agit de toutes les immobilisations détenues par l’entreprise. En clair, votre expert-comptable prend en compte les immobilisations corporelles, à savoir les investissements à long terme tels que des machines dans l’industrie, des véhicules, etc. Mais cette partie du bilan fonctionnel fait également apparaître les immobilisations incorporelles à l’image des logiciels utilisés dans le cadre de votre activité. Enfin, sont indiquées les immobilisations financières, par exemple lorsque vous prêtez de l’argent à un tiers ;
- l’actif circulant d’exploitation (ACE) : il correspond à l’argent que l’entreprise doit gagner sans que celui-ci n’ait été perçu. En clair, sont considérés ici les stocks et les factures clients qui ne sont pas encore réglées. Figurent également les avances et les acomptes ;
- l’actif circulant hors exploitation (ACHE) : on retrouve ici d’autres créances non liées directement à l’activité de l’entreprise. Il s’agit par exemple d’une cession immobilière ;
- la trésorerie active : elle correspond à l’argent dont l’entreprise dispose réellement, le cash disponible, à l’image de l’argent présent sur ses comptes bancaires.
Les ressources (partie droite du tableau)
Les ressources représentent l’origine des fonds mis à la disposition de l’entreprise. Elles montrent d’où provient l’argent utilisé pour financer les emplois, qu’il s’agisse de capitaux propres, d’emprunts ou encore de dettes d’exploitation. En d’autres termes, les ressources traduisent les moyens de financement dont dispose l’entreprise pour assurer son activité et ses investissements.
-
Les ressources stables : elles regroupent les capitaux propres, les amortissements, les provisions pour charges ainsi que les dettes financières à long terme. Ces éléments assurent le financement durable de l’entreprise ;
-
Le passif circulant d’exploitation (PCE) : il correspond aux dettes contractées dans le cadre de l’activité courante, notamment les factures fournisseurs non encore réglées ;
-
Le passif circulant hors exploitation (PCHE) : il désigne l’ensemble des dettes non directement liées à l’exploitation, comme les dettes fiscales et sociales (par exemple, l’impôt sur les sociétés à payer) ;
-
La trésorerie passive : elle regroupe les dettes bancaires à court terme, telles que les découverts bancaires, par opposition aux emprunts à long terme.
Comment faire un bilan fonctionnel ?
Étape 1 : rassembler les documents (bilan comptable)
Le bilan fonctionnel se construit à partir du bilan comptable. La première étape consiste donc à rassembler les différents documents qui permettront de construire le bilan fonctionnel :
-
Bilan comptable (dernier exercice clos) + annexes.
-
Détail des immobilisations (brut / amortissements), des provisions, des dettes (échéances), des créances et des stocks.
Étape 2 : construire la colonne des Emplois
|
Éléments du bilan comptable (Actif) |
Catégorie du bilan fonctionnel (Emplois) |
Justification du reclassement |
|
Immobilisations incorporelles, corporelles et financières |
Emplois stables |
Ces éléments représentent des investissements durables ; ils traduisent l’utilisation à long terme des fonds pour développer l’activité. |
|
Stocks et en-cours de production |
Actif circulant d’exploitation |
Les stocks sont des emplois temporaires liés au cycle d’exploitation : ils mobilisent des ressources en attendant la vente. |
|
Créances clients |
Actif circulant d’exploitation |
L’argent n’a pas encore été encaissé : c’est une utilisation momentanée de fonds en attente de règlement. |
|
Avances et acomptes versés aux fournisseurs |
Actif circulant d’exploitation |
Sommes avancées dans le cadre normal de l’activité : besoin d’exploitation. |
|
Créances diverses hors exploitation (ex. prêt à un tiers, cession d’actif) |
Actif circulant hors exploitation |
Utilisation de fonds non liée directement à l’activité courante. |
|
Disponibilités (banque, caisse) + VMP liquides |
Trésorerie active |
Représentent les fonds immédiatement disponibles, donc des emplois de trésorerie. |
Étape 3 : construire la colonne des ressources
|
Éléments du bilan comptable (Passif) |
Catégorie du bilan fonctionnel (Ressources) |
Justification du reclassement |
|
Capitaux propres (capital, réserves, résultat, etc.) |
Ressources stables |
Financements durables appartenant aux associés : ils soutiennent l’activité sur le long terme. |
|
Amortissements et provisions |
Ressources stables |
Correspondent à des autofinancements ou à des fonds mis de côté : ils renforcent la capacité financière interne. |
|
Dettes financières à long et moyen terme |
Ressources stables |
Financements externes à long terme destinés à couvrir les emplois durables (ex. emprunts bancaires). |
|
Dettes fournisseurs |
Passif circulant d’exploitation |
Financements temporaires octroyés par les fournisseurs en attente de paiement : source de trésorerie d’exploitation. |
|
Dettes fiscales et sociales d’exploitation |
Passif circulant d’exploitation |
Dettes courantes liées au fonctionnement de l’entreprise (TVA, salaires, cotisations…). |
|
Autres dettes non liées à l’exploitation |
Passif circulant hors exploitation |
Obligations hors cycle d’exploitation : impôts sur les sociétés, dettes diverses non récurrentes. |
|
Concours bancaires courants |
Trésorerie passive |
Financement à très court terme pour combler un besoin de trésorerie : signe d’un déséquilibre momentané. |
Étape 4 : vérifier le principe d'équilibre
Dans un bilan fonctionnel, les emplois et les ressources doivent être équilibrés. Le total des emplois doit ainsi être égal au total des ressources. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur dans la construction du bilan fonctionnel.
Bilan fonctionnel : exemple
Un bilan fonctionnel doit être équilibré. Retrouvez un exemple de bilan fictif pour lequel les emplois sont bien équivalents aux ressources.
|
Emplois |
Ressources |
||
|
Emplois stables |
10 000 |
Ressources stables |
20 000 |
|
Actifs circulants |
15 000 |
Passifs circulants |
3 000 |
|
Trésorerie active |
3 000 |
Trésorerie passive |
5 000 |
|
Total |
28 000 |
Total |
28 000 |
Pourquoi faire un bilan fonctionnel ?
Le bilan fonctionnel vise à bénéficier d’une nouvelle vision de la situation financière de l’entreprise et de sa capacité à financer ses investissements à long terme et à couvrir ses dépenses à court et moyen terme.
En clair, le bilan fonctionnel permet de mieux anticiper les éventuelles difficultés liées notamment à la trésorerie, de réaliser les arbitrages nécessaires et de prendre les meilleures décisions pour l’avenir de l’entreprise.
Indispensable pour les chefs d’entreprise, il est également très instructif pour les banquiers afin de les convaincre de vous accorder un prêt, mais aussi pour les investisseurs désireux de s’assurer de la santé financière d’une entreprise avant d’investir.
Comment analyser le bilan fonctionnel ?
Calculer le besoin en fonds de roulement (BFR)
Dans un premier temps, le bilan fonctionnel permet de déterminer le besoin en fonds de roulement pour savoir quelle est la trésorerie nécessaire pour assumer les décalages entre encaissements et décaissements.
Le BFR se calcule comme suit : actifs circulants – passifs circulants. Si l’on reprend notre exemple, le BFR est de 15 000 – 3 000 = 12 000 €. Il est positif, l’entreprise pourrait ainsi être amenée à solliciter un découvert ou une facilité de caisse.
Calculer le fonds de roulement net global (FRNG)
Le fonds de roulement net global se calcule de la manière suivante : ressources stables – emplois stables. Selon notre exemple, le FRNG est de 20 000 – 10 000 = 10 000 €.
Le fonds de roulement correspond à l'argent dont dispose effectivement l'entreprise pour payer ses charges en attendant d'être payée par ses fournisseurs. Le FRNG doit être supérieur au besoin en fonds de roulement. Dans le cas contraire, cela signifie que l'entreprise doit trouver des moyens de financement pour son cycle d'exploitation.
Calculer la trésorerie nette
Enfin, le bilan fonctionnel offre une vision claire de la trésorerie nette. Sa formule de calcul est la suivante : trésorerie active – trésorerie passive, soit, toujours selon notre exemple : 3 000 – 5 000 = - 2 000 €. Une trésorerie nette négative signifie que l’entreprise ne bénéficie pas d’une trésorerie suffisante et qu’elle peut être amenée à faire appel au découvert.
FAQ
-
📌 Quelle différence entre bilan fonctionnel et bilan comptable ?
Le bilan comptable est établi chaque année pour déterminer le résultat
de l’entreprise. Il prend en compte le passif et l’actif. Le bilan fonctionnel
vise à analyser la structure et la santé financière de l’entreprise en
mettant en parallèle les emplois et les ressources. -
Le bilan fonctionnel est-il obligatoire ?
Non, seul le bilan comptable est obligatoire en fin d’exercice. Toutefois, le bilan fonctionnel offrant une vision nouvelle de la santé financière de l’entreprise, il est vivement conseillé.
-
Quel est le but du bilan fonctionnel ?
Le bilan fonctionnel permet d’analyser la structure financière de l’entreprise et de calculer notamment le besoin en fonds de roulement, le fonds de roulement net global ou encore la trésorerie nette.
- Mise à jour du 17 novembre 2025 : vérification des informations comptables.