L’accord de consortium (également appelé « contrat de collaboration de recherche » dans une forme « simplifiée ») est un contrat qui organise la réunion de partenaires autour d’un projet de recherche. Ce dernier peut être de plus ou moins grande envergure. L’accord de consortium détermine les contours légaux et juridiques applicables au groupement de personnes physiques ou morales.
Définition, contenu, rédaction… Maître Marie Marcotte vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce type de contrat visant à mutualiser les moyens, les risques et les résultats d’un projet de recherche.
Qu’est-ce que l’accord de consortium ?
Définition d’un accord de consortium
L’accord de consortium est un contrat de coopération destiné à encadrer les projets de recherche et d'innovation collaboratifs. Ces derniers rassemblent des partenaires privés (entreprises, investisseurs) et généralement des partenaires publics (universités, organismes de recherche). Le plus souvent, aucun flux financier ne transite entre eux. En effet, généralement, le porteur du projet est subventionné pour la mise en œuvre du projet.
Si l’indépendance de tous les membres du consortium est conservée d’un point de vue juridique, il est tout de même nécessaire d’établir un contrat. Jouant le rôle d’un outil de gestion de projet, il régit les rapports et interactions entre les différents acteurs et établit les droits et obligations mutuels des parties.
Comment fonctionne un accord de consortium ?
Un contrat de consortium fixe la durée de la collaboration entre les partenaires. Le plus souvent, elle varie de 36 à 48 mois mais la durée peut être aussi plus courte. Pour simplifier la prise de décision au sein du groupement, un comité de pilotage peut être nommé.
Pour encadrer la vie du consortium, des règles d’entrée et de sortie des membres sont arrêtées. Afin d’être le plus complet possible, l’accord se doit d’anticiper de potentiels conflits. Ainsi, il prévoit des modalités de résolution des litiges susceptibles de se déclencher entre les parties. Enfin, il assure la préservation des droits de propriété intellectuelle antérieurs au projet de chacun des membres (modèles, brevets, marques) ainsi que la répartition des droits de propriété intellectuelle qui seront issus du projet.
Exemples de consortium
En 2016, des acteurs publics et privés se sont réunis pour créer le Consortium de recherche et innovation sur le biocontrôle. L’objectif ? Consolider ce secteur français en plein développement. À l’initiative de l’Inrae, institut de recherche public, le Consortium public-privé associe :
- des organismes de recherche ;
- des acteurs de la recherche-développement ;
- le Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ;
- IBMA France, une association professionnelle ;
- des industriels, comme Bayer ou Syngenta.
Voici d’autres exemples d’accords de consortium :
- le consortium “Intelligence Artificielle en Santé”, lancé en 2020 par BioValley France ;
- le consortium “Parcours”, visant à élaborer une offre de formation préparant aux métiers du futur ;
- le consortium interdisciplinaire “Transformation des aliments et durabilité des systèmes alimentaires”. Il implique plusieurs unités de l’Inrae et le Centre d'études et de recherches sur le développement international (CERDI).
Quelles sont les clauses à insérer dans l’accord de consortium ?
Avant de rédiger un accord de consortium, chaque partenaire se doit de procéder à un état des lieux de ses connaissances antérieures propres. Pour ce faire, il inventorie les savoir-faire, brevets et logiciels protégés par des droits d'auteur :
- acquis avant l’entrée au sein du projet ;
- requis pour sa réalisation.
L’objectif de cet inventaire est de démontrer l’antériorité et la propriété des connaissances préexistantes (background). Même celles ne pouvant pas faire l’objet d’une protection par un titre de propriété intellectuelle sont concernées. Par exemple, un savoir-faire secret, qui ne peut faire l’objet d’une protection, peut être inventorié dans l’accord de consortium. De ce fait, sa préexistence et son appartenance à l’un des membres du groupement sont actées.
Les modalités d’exécution du projet
Pour coordonner les actions de chacun des partenaires durant le projet de recherche, le contrat de consortium fixe :
- Les droits et obligations des parties.
- Les règles de gouvernance, adaptées suivant le type de projet et le nombre de partenaires. Un coordinateur (l’un des membres du consortium) est désigné. Son rôle est de relayer les informations entre les acteurs, de communiquer auprès des organismes de financement et de préparer les travaux du comité de pilotage. Un organe ou comité de gestion est nommé en vue de favoriser le bon déroulement du projet. L’accord de consortium précise les conditions de désignation des membres ou encore la durée de leur mandat. Enfin, un ou plusieurs comités techniques peuvent être mis en place. C’est notamment le cas si le projet est complexe.
- Les règles d’entrée et de sortie des différentes parties du consortium. En règle générale, une clause d’agrément prévoit les conditions de quorum et de majorité essentielles à la prise de décision. Les droits du nouvel entrant peuvent être identiques ou différents par rapport aux autres membres. Concernant la sortie d’un partenaire, il est essentiel d’en déterminer les conséquences, en particulier au sujet de la conservation ou la perte des droits sur les connaissances propres des autres membres et les travaux réalisés.
- Les obligations dont l’effet se prolonge après le projet. Par exemple, l’obligation de confidentialité sur les renseignements échangés continue après la clôture du projet.
Les droits de propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle fait partie des points clés de l’accord de consortium. Comme nous venons de le voir, le contrat protège les connaissances propres antérieures des partenaires. Il garantit aussi la protection des résultats. Deux types de résultats peuvent être distingués :
- les résultats communs, obtenus dans le cadre du projet de recherche ;
- les résultats propres, générés dans le cadre du consortium par un seul membre.
Les partenaires peuvent répartir les résultats de la recherche :
- soit à parts égales ou au prorata des apports de chacun, peu importe leur implication dans le résultat ;
- soit en utilisant une quote-part de propriété, correspondant à l’implication réelle du membre du consortium.
D’autres questions sont à trancher au sujet de la propriété intellectuelle. Parmi elles :
- la compensation en cas d’exploitation des résultats du projet ;
- la gestion des droits de propriété intellectuelle : frais de dépôt, défense des nouveaux brevets, vente des quotes-parts.
Les conditions de publication des informations relatives au projet
Dans le cadre d’un projet de recherche, il est essentiel de bien articuler la publication avec la gestion de la propriété intellectuelle et de la confidentialité. L’accord de consortium régit les parutions en vue de préserver les intérêts des parties. Par exemple, il garantit que les informations commerciales sensibles restent confidentielles jusqu’au dépôt d’un brevet.
Les modalités financières
Au sein de l’accord de consortium est établi un budget global. Il prend en considération les charges de personnel, mais aussi les coûts directs et indirects de chaque partenaire. Les financements européens ou nationaux sont directement versés aux membres du groupement.
Le calendrier de livrables
Doivent être précisés pour chacun des livrables :
- le format utilisé ;
- le contenu d’ordre technique ;
- la nature du contenu au regard des droits de propriété intellectuelle ;
- la répartition des différentes obligations entre les partenaires.
Un calendrier est établi au sein de l’accord de consortium. Ce dernier est indispensable pour contrôler l’avancée du projet.
La non-concurrence entre les membres du consortium
Si plusieurs partenaires exercent des activités sur un même marché, l’organisation de l’exploitation des résultats est primordiale. Elle peut être commune ou, au contraire, séparée. Une répartition des droits d’exploitation selon des domaines d’activité ou selon des critères géographiques peut être prévue dans l’accord de consortium.
La responsabilité des membres du consortium
La responsabilité entre les signataires de l’accord de consortium peut être prévue de manière contractuelle. Vis-à-vis des tiers, le groupement momentané d’entités juridiques distinctes n’a pas la personnalité morale. Par conséquent, les membres ne sont, en principe, pas tenus responsables, solidairement, en cas de fautes commises par les autres parties.
Pourquoi est-il nécessaire de se faire accompagner par un avocat ?
La rédaction de l’accord de consortium est une opération complexe, du fait notamment de la grande liberté contractuelle laissée aux partenaires. Elle fait intervenir diverses parties ayant des intérêt communs, à savoir faire aboutir le projet, mais également des intérêts divergents, par exemple dans le cadre de l’exploitation des résultats issus du projet. En outre, il est toujours délicat d’organiser le partage de propriété intellectuelle et la protection des résultats des travaux, avant même le démarrage du projet.
L’avocat intervient dans la négociation des clauses liées à la propriété intellectuelle et à la prise en compte des connaissances antérieures. En moyenne, la concertation dure un an. Son rôle est de conseiller les parties pour les aider à trouver un équilibre entre leurs droits et obligations.
Au besoin, le professionnel du droit peut rédiger, en attendant la finalisation du contrat de consortium, un accord de confidentialité ou non disclosure agreement (NDA), en anglais.
- L’accord de consortium est la réunion de partenaires privés, voire publics autour d’un projet de recherche.
- Le fonctionnement, la gouvernance ou encore les modalités d’exploitation des résultats sont définis au cas par cas, en fonction du projet de recherche.
- L’établissement d’un contrat de consortium peut être fastidieux et délicat. Cette étape est pourtant indispensable pour permettre aux partenaires de se mettre d'accord, en principe, avant de commencer le projet.




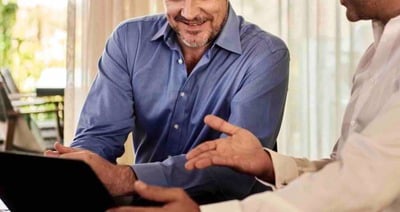







Les commentaires (1)
Bonjour, Votre article est très pertinent. Je me questionne sur un projet de consortium: où se termine la partie recherche et commence la partie inn [...]
Bonjour, Votre article est très pertinent. Je me questionne sur un projet de consortium: où se termine la partie recherche et commence la partie innovation ? Le consortium, tel que je le comprends dans cet article ne par le pas d'une mise sur le marché d'une innovation issue d'une recherche commune. La consortium n'a pas identité d'entreprise et ne peut pas facturer dans ce cadre ? Merci pour votre réponse.
Voir plusmoinsBonjour, merci pour votre commentaire ! En principe, un consortium n'a pas de personnalité juridique et ne peut donc pas mettre un produit sur le marc [...]
Bonjour, merci pour votre commentaire ! En principe, un consortium n'a pas de personnalité juridique et ne peut donc pas mettre un produit sur le marché et facturer. Lorsque la phase de recherche est terminée, plusieurs options sont possibles. Les acteurs composant le consortium peuvent se mettre d'accord pour mettre séparément sur le marché les innovations issues de ce projet de recherche. Ils peuvent également décider de s'associer et de créer une nouvelle entreprise pour commercialiser ces produits. Excellente journée !
Voir plusmoins