Le droit des contrats est guidé par plusieurs grands principes dont celui de l’effet relatif des contrats selon lequel un contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties contractantes. En conséquence, les tiers au contrat ne peuvent ni l’invoquer, ni se le voir appliquer.
Il existe cependant des exceptions à ce principe et on note une tendance des juges à étendre de plus en plus fréquemment certaines clauses contractuelles à des tiers.
Les parties à un contrat pourront donc légitimement se demander comment et quand leur contrat pourra être invoqué par un tiers ou pourra s’appliquer à ce dernier ? Dans ces circonstances, un focus s’impose.
- Qu'entend-on par «effet relatif du contrat » ?
- Le concept distinct de l'opposabilité du contrat
- Les parties à un contrat peuvent-elles le rendre opposable à un tiers ?
- À l'inverse, un tiers peut-il invoquer un contrat auquel il n'est pas partie ?
- Les exceptions à l'effet relatif des contrats
- Focus sur les pactes d'associésl es clauses de non-concurrence et de l'exclusivité
- Pourquoi se faire accompagner par un contrat ?
Qu'entend-on par «effet relatif du contrat » ?
L’effet relatif du contrat désigne l’idée selon laquelle un contrat ne peut produire d’effet qu’entre ses parties.
Ce principe est posé à l’article 1199 du Code civil : « « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter ».
Donc, seules les parties ayant échangé leur consentement au moment de la conclusion du contrat sont tenues par ses termes et peuvent l’invoquer.
Notez que sont considérés comme « parties » au contrat :
- les contractants qui ont exprimé leurs volontés (qu’ils aient signés le contrat directement ou qu’ils se soient faits représenter pour la signature) ;
- les ayants-cause s’agissant de contractants personnes physiques ;
- les sociétés absorbantes ou fusionnantes s’agissant de contractants personnes morales ;
- les cessionnaires du contrat.
Le concept distinct de l'opposabilité du contrat
L’opposabilité du contrat signifie qu’en tant que fait juridique, un contrat doit être respecté par les tiers, bien qu’il ne crée pas d’obligations à leur égard. Le tiers a l'obligation de laisser le contrat s’exécuter sans entrave.
Ce principe est prévu à l’article 1200 du Code civil : « « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait ».
Cet article ne précise pas si le tiers doit avoir connaissance ou non du contrat, néanmoins, si les tiers doivent respecter la situation juridique créée par un contrat, c’est à la condition qu’ils en aient eu connaissance.
Les parties à un contrat peuvent-elles le rendre opposable à un tiers ?
En vertu de l’effet relatif des contrats, les tiers ne peuvent pas être contraints d'exécuter le contrat puisqu’il ne peut pas créer d'obligations à leur charge, sans leur consentement. Par extension un contrat ne peut pas davantage réduire leurs droits.
Mais il existe des cas où les parties peuvent rendre leur contrat opposable aux tiers :
- Pour rapporter une preuve : par exemple, une partie à un contrat de mariage, d’adoption ou à des statuts de société pourra toujours invoquer ces contrats pour justifier de sa situation vis-à-vis des tiers.
- Pour engager la responsabilité d’un tiers qui aurait agi en violation du contrat ou provoqué son inexécution. Quelques illustrations :
- Dans une affaire jugée en 2008, le vendeur d’un appartement avait missionné un agent immobilier et s’était engagé par un contrat à lui verser une commission s’il trouvait acquéreur. Un couple s’est présenté sous une fausse identité auprès de l’agent immobilier afin de visiter le bien et s’est ensuite porté acquéreur directement auprès du vendeur sous sa véritable identité, privant ainsi l’agent immobilier de sa commission. L’agent immobilier a pu engager la responsabilité des acquéreurs alors même qu’ils étaient tiers au contrat. (Cour de cassation, 9 mai 2008, n°07.12449).
- Si un salarié qui rompt son contrat de travail avant terme (dans le cadre d’un CDD) du fait des incitations d’une entreprise concurrente de la sienne, alors l'entreprise qui l'y a incité en connaissance de cause est tiers responsable de la violation du contrat (article L. 1237-3 du Code du travail).
À l'inverse, un tiers peut-il invoquer un contrat auquel il n'est pas partie ?
Les tiers peuvent invoquer un contrat dans les hypothèses suivantes :
- Pour rapporter une preuve (article 1200 du Code civil alinéa 2) ;
- Pour engager la responsabilité délictuelle d’un cocontractant qui, du fait d’un manquement contractuel, lui aurait causé un dommage. Les exemples sont nombreux :
- dans le cas d’un accident avec une voiture de location causé par une anomalie sur le véhicule, les passagers victimes peuvent engager la responsabilité du loueur même si le conducteur était le seul signataire du contrat de location (Cour de cassation, 7 novembre 1973, n° 71-12.424) ;
- dans le cadre de contrats de distribution sélective, un tiers peut engager la responsabilité d’une entreprise concurrente agissant en violation de ces contrats lorsque cela entraîne une concurrence déloyale (Cour de cassation, 1 juillet 2003, n° 99-17.183).
Notez qu’il n’est pas nécessaire pour le tiers de rapporter l’existence d’une faute, autre que le manquement contractuel (Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 octobre 2006, 05-13.255).
- En présence d’un pacte de préférence ou de la promesse unilatérale de contrat : le Code civil prévoit en ses articles 1123 et 1124 que le tiers bénéficiaire du pacte ou de la promesse peut en invoquer la nullité lorsqu’il y a une méconnaissance de ses droits.
Les exceptions à l'effet relatif des contrats
On distingue classiquement deux catégories de contrats qui rayonnent au-delà des parties contractantes : les contrats pour autrui d’une part et d’autre part les contrats qui n’ont pas vocation à s’étendre à autrui mais imposent certains effets aux tiers.
Exemples de contrats pour autrui (article 1205 du Code civil) :
- Les contrats collectifs : le règlement de copropriété s’impose aux acquéreurs successifs sans qu’ils en soient signataires.
- Les contrats faits dans l’intérêt des tiers :
- Dans les contrats d’assurance vie, le stipulant verse une somme d’argent à la société d’assurance (ou banque), et le promettant s’engage au décès du stipulant à verser une somme convenue au tiers bénéficiaire.
- Le contrat de fiducie visé à l’article 2011 du Code civil peut être défini comme l’opération par laquelle le contractant transmet des biens à un fiduciaire qui a pour mission de les conserver afin de les remettre plus tard au bénéficiaire.
Exemples de contrats étendus aux tiers :
- Les contrats attachés aux choses : certaines obligations comme les servitudes sont attachées aux biens et sont donc transmises avec.
- Les contrats cédés : les contrats de travail sont cédés, lors de la reprise d’une entreprise, au repreneur (article L. 1224-1 du Code du travail) ; le contrat de bail est cédé à l’acquéreur du bien immobilier loué (article 1743 du Code civil) ; le contrat d’assurance est cédé avec le bien assuré lorsqu’il est aliéné (article L.121-10 du Code des assurances).
- La simulation : il s’agit d’une hypothèse prévue à l’article 1201 du Code civil selon laquelle les tiers peuvent se prévaloir d’un contrat occulte dissimulé par un contrat apparent qui produit effet entre les parties mais n’est pas opposable aux tiers.
- Les chaînes de contrats ayant pour objet la transmission d’une chose : dans le cas de ventes successives, les actions en garantie des vices cachés ou pour défaut de conformité sont naturellement dues à l’acheteur immédiat, mais aussi à tous les sous-acquéreurs successifs de la chose, et ce même si la chaîne de contrats est hétérogène car l’effet du contrat suit la chose transmise (Cass. 1re civ., 21 janv. 2003, n° 00-19.513).
- Les actions directes en paiement : permettent au tiers à un contrat, créancier d’une partie à un contrat, d'exercer le droit de cette dernière contre son cocontractant. (article 1341-3 du Code civil). Par exemple, dans le cas d’une sous location, le bailleur peut directement agir contre le sous-locataire en cas d’impayé.
Attention, la promesse de porte fort, parfois citée comme un exemple de contrat fait « pour autrui » est en réalité une fausse exception au principe de relativité du contrat puisque le tiers qui fait le choix de ratifier l’acte devient partie au contrat (qui fait l’objet de la promesse) doit ratifier l’acte et devient donc ainsi partie au contrat.
Focus sur les pactes d'associésl es clauses de non-concurrence et de l'exclusivité
Le principe de relativité du contrat s’applique aux pactes d’actionnaires mais il faut être vigilant car les juges ont tendance à étendre la possibilité pour les tiers à ces contrats de les invoquer ou de se les voir imposer.
Traditionnellement, les juges considéraient que la société dont les associés avaient signé un pacte d’associés, ne pouvait se prévaloir de ce pacte (lorsque la société n’est pas elle-même signataire), et que seuls les signataires le pouvaient (CA Paris, 14 juin 2006, n° 04/00617 : JurisData n° 2006-311145).
Cependant la jurisprudence plus récente a une analyse différente concernant les tiers. Ainsi, la Cour de cassation a autorisé un salarié à se prévaloir des clauses d'un pacte d'associés, auquel il n’était pas signataire, qui prévoyait une procédure particulière pour le licenciement qui n’avait pas été respectée, cela lui ayant causé un préjudice (Soc. 18 mars 2009, n° 07-45.212).
Suivant le même raisonnement d’extension aux tiers, une action en concurrence déloyale a pu être engagée contre une société tiers à un pacte d’associés contenant une clause d’exclusivité dès lors qu’elle avait embauchée l’ancien dirigeant de la société plaignante et que ce dernier avait commis des actes de concurrence déloyale (Cass. com., 18 déc. 2007, n° 05-19.397).
Suivant cet exemple, les clauses de non concurrence et d’exclusivité sont également de plus en plus souvent étendues aux tiers.
Par exemple, il avait été jugé en 2007 que seul le bailleur signataire du contrat de bail commercial pour un local situé dans un centre commercial, devait respecter la clause d’exclusivité insérée dans le contrat (Cass. 3e civ., 3 mai 2007, n° 06-11.591). En conséquence, les tiers n’étaient pas tenus de respecter cette clause.
Pourtant dès 2010 une solution différente est retenue s’agissant d’une clause de non concurrence insérée dans un contrat de cession de bail commercial, car les juges considéraient que le tiers locataire pouvait valablement invoquer un manquement à la clause de non concurrence pour faire interdire au contractant de cesser d’exercer toute activité concurrentielle (Cass. 3e civ., 13 juill. 2010, n° 09-67.516).
On peut imaginer que cette solution sera transposable au cas de la clause d’exclusivité également.
Pourquoi se faire accompagner par un contrat ?
L’extension des clauses contenues dans certains contrats à des tiers peut créer un sentiment d’insécurité juridique puisque les parties signataires qui s’obligent l’une envers l'autre peuvent craindre, à raison, l’intervention de tiers.
Il est donc important d’être accompagné par un avocat au moment de la formation d’un contrat, afin d’identifier les clauses contractuelles qui pourraient s’étendre aux tiers.






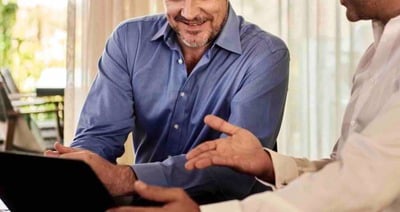

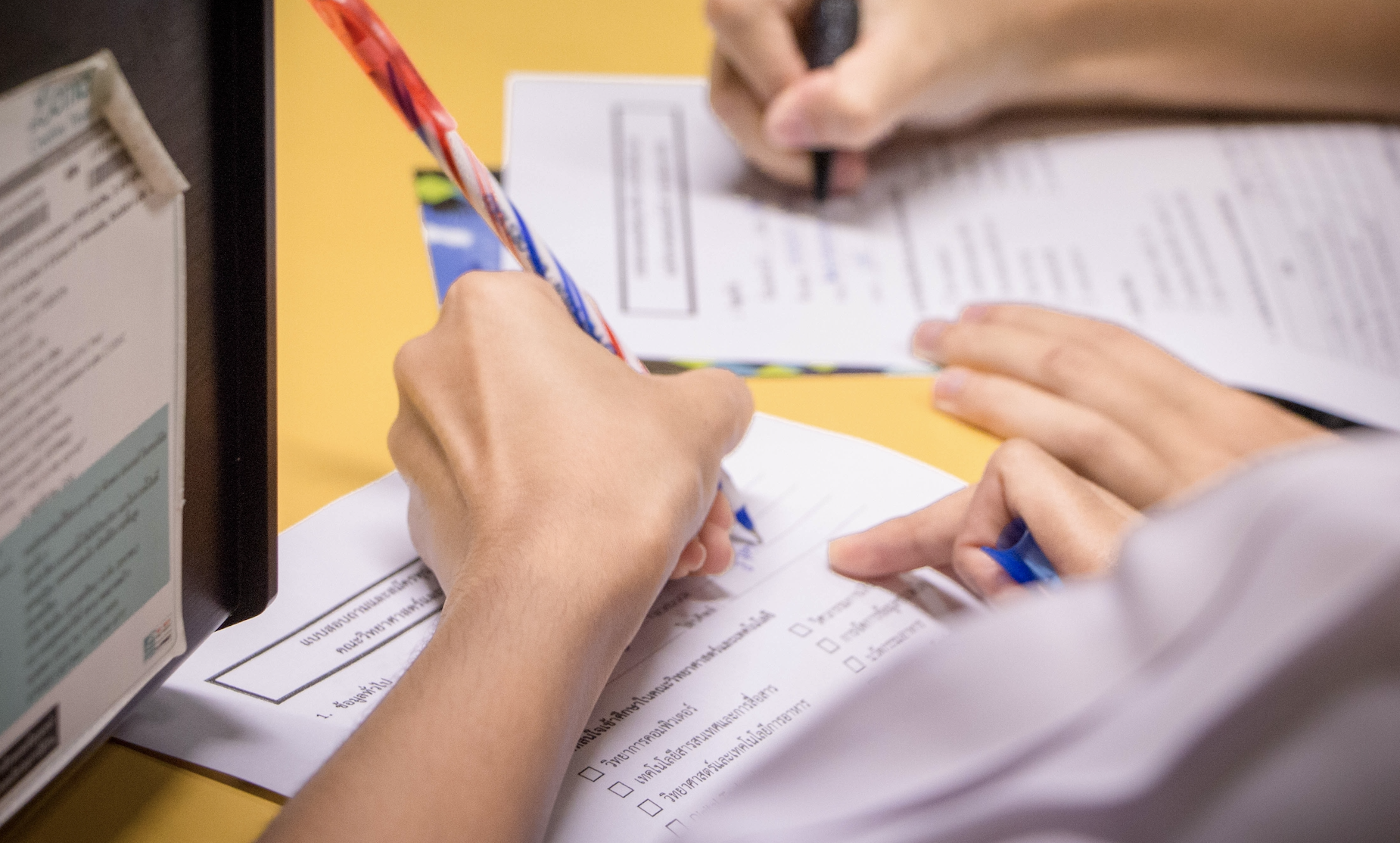

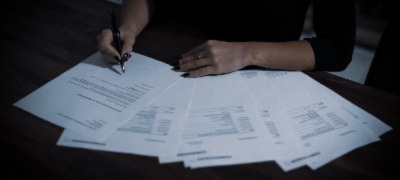



Les commentaires (1)
Je suis jeune étudiant juriste malien en formation, et pour mes recherches en droit commercial et beaucoup d'autres je conseille vivement le site au a [...]
Je suis jeune étudiant juriste malien en formation, et pour mes recherches en droit commercial et beaucoup d'autres je conseille vivement le site au autres qui souhaitent avoir une information de qualité dans le contexte de droit. Merci
Voir plusmoinsBonjour, nous vous remercions chaleureusement pour votre commentaire ! Excellente journée !